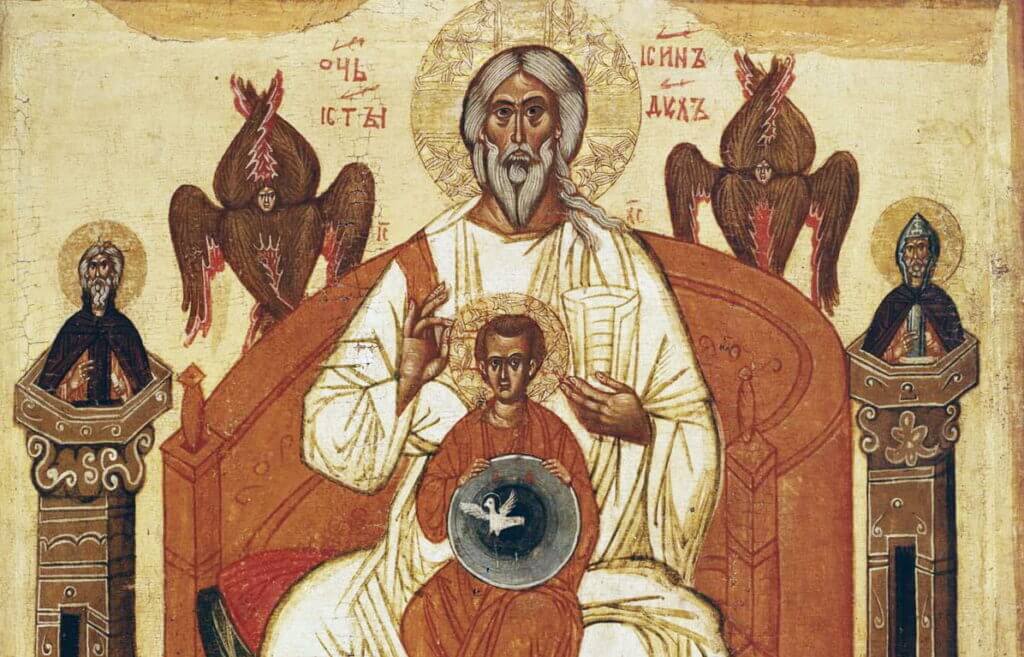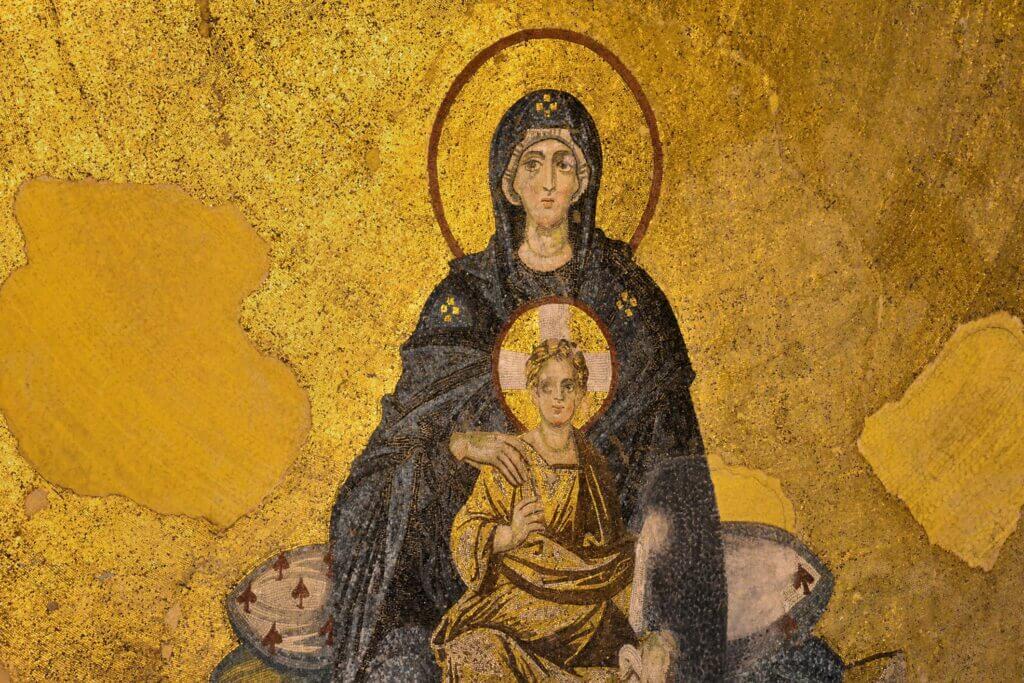Certains de nos lecteurs seront peut-être surpris d’apprendre que le pape saint Pie X fit preuve de bienveillance envers les rites orientaux (précisons bien qu’il s’agit des rites orientaux catholiques : il est toujours interdit de prendre part à un rite des orientaux séparés de Rome (dits« orthodoxes ») et d’y communier, même un dimanche).
Saint Pie X a succédé à Léon XIII, et les historiens ont tendance à exagérer le contraste entre les deux pontifes : alors que Léon XIII a laissé le souvenir d’un pape d’esprit ouvert, voire audacieux (dans sa volonté d’entente avec la IIIe République en France, en particulier), saint Pie X apparaît avant tout, aux yeux des historiens, comme un pape « de combat », dans sa lutte contre les erreurs modernes regroupées sous le nom de « modernisme ». Et l’on présenterait facilement son action comme un net abandon de la politique de « conquête » et d” « ouverture » du pontificat précédent, au profit d’une stratégie toute de « concentration » des forces catholiques pour préserver le bastion de la vérité que doit demeurer la Sainte Église romaine…
Et, pour ce qui est du monde des chrétiens d’Orient, les grandes entreprises « unionistes » (consistant à favoriser le retour à l’unité des chrétiens séparés dans le respect de leurs traditions) semblent désormais passer au second plan, alors qu’elles constituaient un axe majeur du pontificat de Léon XIII (cette politique avait culminé avec le Congrès eucharistique de Jérusalem en 1893). Pourtant, et c’est d’autant plus remarquable dans le contexte difficile des années 1900–1910, saint Pie X ne négligea nullement les demandes venant des chrétiens d’Orient, monde qui a priori ne relevait ni de sa formation ni de ses préoccupations.
La constitution Tradita ab antiquis
C’est ainsi que le saint pape encouragea discrètement, mais vivement, l’archevêque majeur des gréco-catholiques ukrainiens, Mgr André Szeptycki (Cheptitskij, selon la graphie ukrainienne), à développer un apostolat en Russie tsariste. De même, exemple très révélateur, saint Pie X engagea expressément, en 1913, les époux Vladimir et Anna Abrikosov, couple de Saint-Pétersbourg récemment converti de l’orthodoxie russe au catholicisme, à ne pas abandonner leur patrie et leur rite byzantin, comme ils en avaient le projet avec la perspective d’entrer en religion en Occident : c’est en restant dans le rite byzantin qu’ils devaient être à la fois authentiquement catholiques et authentiquement russes ; c’est ainsi qu’ils seraient – et qu’ils furent effectivement – missionnaires auprès de leurs compatriotes (lui, comme prêtre catholique byzantin, expulsé dès 1922 ; elle, comme fondatrice d’un Tiers Ordre régulier dominicain à Moscou, qui allait subir de plein fouet les persécutions staliniennes).
Dans la continuité de ses prédécesseurs, mais avec la volonté de rendre définitives leurs décisions, saint Pie X publia en 1912 un texte fort important et qui allait faire date : la constitution apostolique Tradita ab antiquis, qui fit le point sur : « la réception de la très sainte Eucharistie en des rites différents ». Le contexte doit être rappelé. Depuis quelques dizaines d’années, des demandes d’assouplissement des règles sur ce sujet parvenaient au Saint-Siège : des catholiques occidentaux étaient appelés, pour des raisons professionnelles, à séjourner de façon durable dans des contrées d’Europe orientale ou du Proche-Orient, où l’Église latine était fort peu présente… Devaient-ils alors s’abstenir de recevoir les sacrements, puisqu’à l’époque les règles canoniques interdisaient de communier dans un autre rite que celui de son baptême ? Ponctuellement, sous Léon XIII, des permissions furent accordées. Par ailleurs, on avait à tenir compte des perspectives de conversions en nombre de chrétiens orientaux à l’Église romaine, en ces années-là : en Inde, en Perse, mais aussi peut-être du côté de l’Empire russe… Enfin, au Proche-Orient, des congrégations latines s’implantaient et engageaient les catholiques orientaux sur la voie de la communion fréquente, guère en usage en Orient (ni non plus d’ailleurs en Occident, jusqu’au décret libérateur alors tout récent de saint Pie X, en 1905). Tout cela amena saint Pie X à reconsidérer à fond la question et à assouplir la discipline sacramentelle.
Il en résulta cette constitution apostolique, datée du 14 septembre 1912, qui commence par une présentation historique rapide mais soignée. Nos lecteurs les plus intéressés pourront se reporter au texte lui-même, présent sur La Porte Latine.
Et il nous semble qu’il vaut la peine de résumer la chronologie de la discipline sacramentelle, telle que ce texte pontifical nous la présente et sans nous priver d’en donner quelques citations textuelles.
Historique de la communion en des rites différents
1) A l’origine, « les fidèles en voyage pouvaient, suivant la diversité des lieux, et pourvu que tout danger de superstition ou d’idolâtrie fût écarté pour eux, se plier, sans aucune difficulté, à la variété des coutumes et des rites sacrés. Cet usage s’est introduit pour entretenir la paix et l’union entre les nombreux membres d’une seule Église catholique, ou entre les Églises particulières, selon ce mot de saint Léon IX [au XIe siècle] : « Ne sont en rien un obstacle au salut des croyants les coutumes qui varient suivant les temps et les lieux, alors qu’une seule foi, qui opère par la charité tout le bien qu’elle peut, recommande tous les fidèles à un seul Dieu. » Il s’y ajoutait un autre motif : la nécessité des fidèles, qui, dans les pays étrangers où ils arrivaient, n’avaient la plupart du temps à leur disposition ni églises ni prêtres de leur rite (…). Clercs et laïques en voyage avaient libre accès au ministère eucharistique ou à la communion dans des rites différents du leur. »
2) Au début du second millénaire eut lieu un changement complet du contexte et des directives : « Lorsqu’un schisme lamentable eut détaché du centre de l’unité catholique une grande partie de l’Orient chrétien, il ne fut pas possible de conserver plus longtemps une coutume si louable. En effet Michel Cérulaire [le patriarche de Constantinople fauteur du schisme de 1054], non content de calomnier les coutumes et les cérémonies des latins, décrétait même ouvertement illicite et nulle la consécration du pain azyme [= sans levain]. C’est alors que les pontifes romains interdirent aux latins, pour éloigner d’eux le péril d’erreur, de consacrer ou de recevoir l’eucharistie sous les espèces du pain fermenté. »
3) Nouvelle donne à la fin du Moyen Âge, avec le rapprochement entre les Orientaux séparés et Rome : le concile de Florence, qui proclama l’union entre Rome et Constantinople en 1439, décide de revenir à l’ancienne discipline : pour le maintien de la paix, il est permis de communier en des rites différents… Mais le peu d’effet de l’union proclamée ne permit pas à ces dispositions d’être vraiment appliquées… Et même, quelques mesures en sens contraire, visant surtout à interdire aux latins de communier dans les rites orientaux, furent prises au XVIIIe siècle, pour l’Italie du sud (le rite gréco-catholique, dit « italo-grec », s’y est maintenu, butte-témoin du temps où une bonne partie de la péninsule italienne était partie intégrante de l’Empire byzantin) ; en plein XIXe siècle encore, le Saint-Siège prenait des dispositions analogues pour les Melkites et les Coptes au Proche-Orient …
4) Mais là n’était pas la véritable tradition, dont la restauration se préparait. Le premier concile du Vatican en effet étudia cette question : la commission chargée des rites orientaux élabora un décret accordant aux fidèles la permission de communier dans les deux rites… Mais le concile dut se séparer avant d’avoir pu l’approuver. Le pape Léon XIII prit par la suite (comme on l’a indiqué plus haut) des mesures allant dans ce sens.
Décisions de saint Pie X
Après avoir dressé ce tableau, saint Pie X prend la décision, pour favoriser la concorde entre catholiques de rites différents et pour encourager la communion fréquente, de supprimer toutes restrictions à la possibilité pour un catholique de communier en quelque rite approuvé que ce soit, « selon l’usage ancien de l’Église, afin que (suivant un passage de la session XIII du concile de Trente), tous et chacun de ceux qui portent le nom de chrétiens puissent enfin s’entendre et s’accorder dans ce symbole de la concorde. » Et le saint pape achève son étude historique et disciplinaire en citant la Ière Épître de S. Paul aux Corinthiens (I Co 10, 17), qui sert d’antienne de communion de la messe pour le retour à l’unité des chrétiens (messe votive ad tollendum schisma) : « Puisqu’il y a un seul pain, nous formons un seul corps tout en étant plusieurs, nous qui participons tous à un même pain. » Le texte pontifical se conclut sur des prescriptions très claires, dont la principale a été reprise textuellement dans le Code de droit canonique alors en préparation et publié en 1917 (canon 466 § 1) : « Il est permis à tous les fidèles, de quelque rite qu’ils soient, pour satisfaire leur dévotion, de recevoir la sainte Eucharistie, quel qu’ait été le rite de consécration. » Il est seulement rappelé qu’il faut, autant que faire se peut, faire sa communion pascale dans son rite propre.
Que conclure de tout cela, sinon que la véritable tradition de l’Église est celle qui a été remise à l’honneur par saint Pie X ? Lorsqu’on est en présence d’une liturgie digne de ce nom (c’est-à-dire, d’une liturgie approuvée et transmise par les siècles, et non pas forgée de toutes pièces sous prétexte de s’adapter au monde), lorsque cette liturgie est célébrée par des ministres catholiques, c’est-à-dire reconnaissant l’autorité du successeur de saint Pierre, il est permis sans restriction d’y assister et d’y prendre part par la sainte communion, lorsqu’on est en voyage dans un pays oriental, mais aussi pour de simples motifs de piété – lorsque, par exemple, on a l’occasion de suivre une cérémonie célébrée par des prêtres orientaux en voyage. Le rite qu’ils pratiquent est une richesse de l’Église universelle ; pour peu qu’on soit un peu initié à ce rite (par un livret bien constitué par exemple), et qu’on s’y associe avec dévotion et non par souci déréglé de faire de l’exotisme, la piété et la foi n’y perdront rien, bien au contraire.
Néanmoins, il nous faut ajouter, pour que notre exposé soit complet, qu’il ne serait pas normal de délaisser de façon habituelle son rite propre : les textes officiels nous l’indiquent, ainsi que le simple bon sens. A moins qu’agir ainsi soit la seule façon d’assister à un rite catholique irréprochable. Le cas n’est pas chimérique ; nous connaissons plus d’un catholique « latin » qui, à la fin du XXe siècle, fuyant des « nouvelles messes » qui les choquaient à juste titre, furent heureux de trouver des lieux de culte catholiques orientaux à leur portée, qui leur permirent de protéger leur foi et leur piété.