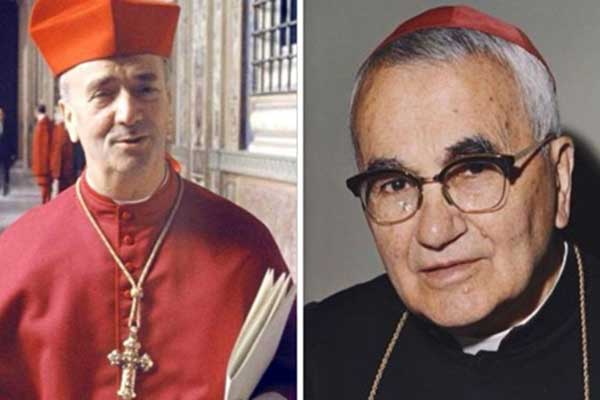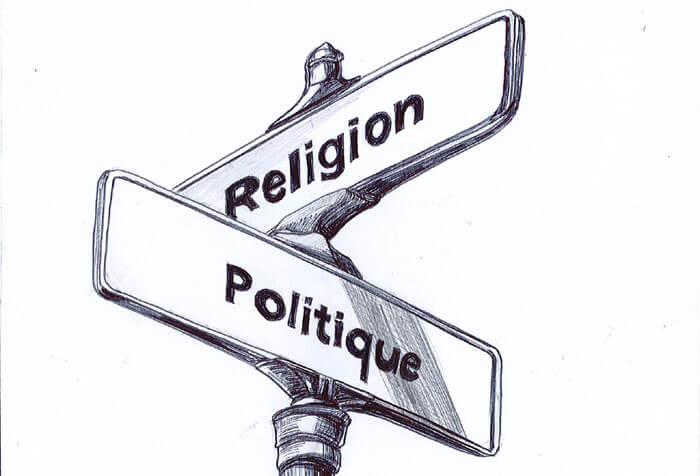« Il faut que nous comprenions bien le rôle de la femme dans le péché pour bien comprendre son rôle dans la Rédemption. Ève explique Marie ».
Thomas Dehau, op, Eve et Marie, 1950, p. 76.
Le 8 décembre 1854, dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus, le pape Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception ; le 2 février 1904, dans l’encyclique Ad diem illum, le pape saint Pie X enseigne que la Mère de Dieu fut associée à son Fils dans l’acte rédempteur de tout le genre humain ; le 11 octobre 1954, dans l’encyclique Ad caeli reginam, le pape Pie XII s’appuie sur ce double enseignement de ses prédécesseurs pour déclarer que la Mère de Dieu partage également la royauté de son Fils sur toutes les âmes. De la sorte, depuis plus d’un siècle et demi, les papes ont préparé les voies pour une future définition dogmatique : celle-ci, espérons-le, pourrait proposer à la foi de toute l’Église catholique ce qui serait le dogme de la Médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie. Cette affirmation solennelle viendrait à point nommé pour dissiper toutes les équivoques issues du concile Vatican II. En effet, l’une des conséquences de cet œcuménisme dont s’inspire la nouvelle théologie est le refus plus ou moins larvé de l’idée de médiation. Dans le cas du Christ, comme dans le cas de sa sainte Mère, l’idée de médiation, réelle et objective, est remplacée par l’idée de la sacramentalité : tout comme son divin Fils, la Sainte Vierge est présentée surtout comme un modèle pour la conscience de l’Église ; c’est d’ailleurs l’idée qui apparaît dans le chapitre 8 de la constitution Lumen gentium. Remarquons enfin ceci : cette vérité de la médiation mariale nous donne accès à l’intelligence profonde d’un mystère qui est pour l’heure, et providentiellement, au centre de la dévotion du peuple catholique, le mystère du Cœur Immaculé et douloureux de Marie. Si ce mystère venait à être mieux déclaré par le recours à ces enseignements du magistère, nul doute que cette dévotion qui l’exprime prendrait tout son sens et gagnerait plus de profit.
État de la question.
La théologie distingue deux aspects dans la médiation du Christ. Il y a d’une part la médiation objective qui équivaut à l’acte de la rédemption ; par cet acte, le Christ a acquis le salut comme dans sa cause ou en principe, et pour tout le genre humain. C’est l’acte unique et définitif du Vendredi Saint[1]. Il y a d’autre part la médiation subjective, qui équivaut à l’acte que le Christ exerce désormais comme chef invisible de la société visible de l’Église, et en recourant à ces instruments séparés que sont les sacrements. Cette activité est multiple et répétée si on la considère du côté des créatures ; le Christ agit ainsi pour dispenser la grâce du salut et exercer sa médiation non plus en principe mais effectivement et pour chaque individu en particulier[2]. Toutes proportions gardées, la même distinction vaut si l’on parle du concours apporté par la Très Sainte Vierge Marie à l’activité rédemptrice du Christ. On parlera de Marie corédemptrice, pour désigner le concours à la rédemption objective ; et on parlera de Marie médiatrice de toutes grâces pour désigner le concours à la rédemption subjective. Les considérations qui suivent s’en tiennent principalement au premier de ces deux aspects.
Difficulté de la question.
Il semble que la Très Sainte Vierge Marie ne puisse pas coopérer à l’acte de la rédemption, précisément dans la mesure où cet acte est celui par lequel le Christ rachète le genre humain tout entier. Coopérer à l’acte de la rédemption, tout fidèle baptisé le peut, dans la dépendance du Christ et dans la mesure où toute satisfaction humaine imparfaite tire sa valeur de la satisfaction parfaite de l’Homme-Dieu[3]. C’est le sens de l’affirmation de l’apôtre saint Paul aux Colossiens :
« Ce qui manque aux souffrances du Christ, je le complète en ma chair pour son corps qui est l’Église »[4].
Néanmoins, une telle coopération reste essentiellement subordonnée, car nul ne peut acquérir pour soi la première grâce ; et partant, une telle coopération est essentiellement restreinte, si bien que nul ne peut acquérir la grâce pour tous les fidèles de l’Église. Lorsque les saints coopèrent à la passion du Christ, la valeur de leur acte peut certes profiter à toute l’Église, mais seulement comme un exemple et un modèle à imiter [5] ; seul l’acte du Christ possède cette valeur satisfactoire et rédemptrice suffisante pour le salut du genre humain tout entier[6]. Ainsi en va-t-il de la Très Sainte Vierge, comme de toute créature : elle dépend de l’acte rédempteur du Christ, puisque c’est cet acte qui est au principe de la première grâce de Marie, qui est la grâce de l’Immaculée Conception. Cette dépendance la met au même rang que nous et lui interdit de coopérer à la passion, comme à l’acte qui rachète le genre humain tout entier. Il semble alors logique de réduire la médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie à l’exercice d’une causalité exemplaire, comme l’a fait Vatican II. Ajoutons ceci : l’acte de la rédemption se réalise par un sacrifice sanglant, où le Christ offre sa vie comme satisfaction pour le péché ; et de fait, la Très Sainte Vierge Marie n’a pas coopéré à une telle action en offrant sa propre vie comme satisfaction pour le péché, alors que d’innombrables martyrs l’ont fait[7].
Solution de la question.
Cependant, les papes enseignent clairement que la Très Sainte Vierge Marie a pu être associée à un titre unique à l’acte rédempteur où le Christ accomplit la rédemption de tout le genre humain. Ce sont en particulier les affirmations explicites de saint Pie X : « Marie mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l’humanité déchue »[8] ; de Benoît XV : « On peut bien dire que Marie a racheté le genre humain avec le Christ » [9] et de Pie XII : « Dans l’accomplissement de la rédemption, la Très sainte Vierge fut certes très étroitement unie au Christ » [10]. De plus, la Tradition [11] appelle Marie la « nouvelle Eve » et signifie par-là que Marie se tient au Christ dans l’œuvre de la rédemption comme Eve se tient à Adam dans l’œuvre du péché ; or Eve fut l’associée d’Adam pour précipiter dans le péché tout le genre humain ; la Tradition affirme donc implicitement que Marie fut l’associée du Christ pour accomplir la rédemption de tout le genre humain[12].
Explication de la solution.
Dans l’encyclique Ad diem illum, le pape saint Pie X donne l’explication de cet enseignement :
« Marie dépasse toute créature par sa sainteté et par l’union qui la rattache au Christ ; associée par le Christ à l’œuvre du salut du genre humain, elle nous mérite pour ainsi dire par convenance ce que le Christ nous mérite en toute justice. »[13]
Ajoutons à cela que le rachat du genre humain tout entier est accompli par le Christ dans la mesure où l’acte de sa passion mérite en toute justice toutes les grâces du salut pour tout le genre humain. Il en résulte que la Très Sainte Vierge a pu mériter par convenance toutes les grâces du salut pour tout le genre humain, ce qui équivaut à dire que la Très Sainte Vierge a pu racheter le genre humain tout entier avec le Christ. En d’autres termes, être corédempteur avec le Christ cela signifie mériter par convenance, c’est-à-dire dans la dépendance du mérite en toute justice du Christ. Ce mérite subordonné découle du mérite en toute justice et le suppose. Et dans le cas de la Très Sainte Vierge, ce mérite par convenance obtient, dans la dépendance du mérite en toute justice du Christ, la rédemption du genre humain tout entier. Tout dépend en effet de la charité qui est au principe du mérite, car l’effet du mérite correspond au principe du mérite et le principe du mérite est la charité ; et la charité de la Très Sainte Vierge est justement d’un ordre à part, car c’est une charité qui est au principe d’un mérite unique en son genre et singulier, qui est de nature à obtenir, par convenance, comme son effet propre, la rédemption du genre humain tout entier.
Pour comprendre, songeons que la charité est obtenue chez la créature par le mérite du Christ qui satisfait pour le péché de cette créature. Et le Christ satisfait pour la Très Sainte Vierge d’une manière plus sublime que pour le reste des autres créatures, car cette satisfaction la soustrait d’avance au péché qu’elle ne contracte pas[14]. Moyennant quoi, la charité de la Très Sainte Vierge est d’un ordre absolument unique, car c’est la charité d’une créature qui n’a pas contracté le péché originel, charité de l’Immaculée Conception ou charité de la première rachetée. Première non selon le temps mais selon le plan de la sagesse divine : car pour être rachetée et dépendre de l’acte rédempteur du Christ, Marie n’est pas rachetée au même titre que les autres créatures et elle ne dépend pas du Christ comme celles-ci dépendent de lui.
« La grâce est donnée à Marie à l’instant précis où elle devrait en devenant fille d’homme assumer ce péché. D’un côté il y a le genre humain considéré comme un seul homme pécheur dont Adam est le chef. Et Jésus meurt en son nom pour réparer ce péché. De l’autre il y a Marie qui n’est pas englobée dans ce péché collectif ni dans cette réparation. Sa rédemption consiste précisément à être mise à part de la nature pécheresse, à ne pas avoir à bénéficier d’une réparation qui vise un péché avec lequel on ne peut lui trouver aucune solidarité. Et si cette création dans la grâce qui est l’effet propre pour Marie de la mort de Jésus peut cependant être appelée une rédemption, c’est d’une autre façon que pour le genre humain. Le sacrifice du Christ vaut donc à part pour la Sainte Vierge et à part pour tout le reste du genre humain »[15].
Marie est rachetée en prévision des mérites du Christ et « avant » que soit racheté tout le reste du genre humain : cet « avant » n’exprime pas bien sûr une antériorité temporelle qui distinguerait deux actes de rédemption ; cette expression désigne plutôt un ordre entre des effets découlant distinctement du même acte rédempteur, et c’est l’ordre selon lequel la divine Sagesse a voulu que soient acquises les grâces du rachat. Pour exprimer cet ordre de manière un peu moins abstraite, le pape saint Pie X évoque l’image de saint Bernard : Marie est comme l’aqueduc qui reçoit toutes les eaux, avant de les répandre toutes dans tous les canaux. Ou encore, pour reprendre la comparaison de saint Bernardin de Sienne, Marie est comme le cou, qui rattache le corps à la tête et concentre d’abord en lui toutes les influences de la tête avant de les transmettre au corps. La charité de Marie étant antérieure, selon le point de vue signalé, à celle de tout autre, il lui est alors possible de coopérer à cette œuvre du rachat universel, en méritant dans la dépendance du Christ le principe du mérite pour le reste de tout le genre humain.
« La souffrance du Christ rachète d’abord la Vierge en ce sens qu’elle obtient sa création en dehors de la solidarité avec le péché humain dont sa conception dans la chair était la cause naturelle ; puis elle s’adjoint la souffrance et le mérite de la Vierge pour racheter avec elle l’ensemble du genre humain pécheur. L’acte rédempteur reste alors indivisible si le rachat de Marie qui est son premier effet est ordonné au rachat de tous les hommes, si la rédemption du genre humain commence dans celle de Marie qui ne lui est antérieure que pour concourir à la réaliser, si la grâce de l’Immaculée Conception ne la sépare du corps des autres rachetés que pour la rendre capable d’agir sur lui »[16].
La grâce de l’Immaculée Conception, qui équivaut à la grâce d’un rachat antérieur et plus sublime, est de la sorte non point la cause de la corédemption mais sa condition : elle y est nécessaire, bien qu’elle n’y suffise pas. Elle la rend seulement possible. La véritable cause, qui fait de la corédemption non plus une possibilité mais une réalité, ne saurait être que la libre décision de Dieu, fondée sur une convenance. Cette convenance est le fait même de la maternité divine : Marie seule est capable de mériter en souffrant d’une manière unique, comme seule une mère peut souffrir de la mort de son fils. Dès lors que, dans le plan de la sagesse divine, le mode concret de notre délivrance doit être celui d’un rachat et donc d’une passion, si Dieu décide d’associer une créature privilégiée à la souffrance du Christ, il ne saurait être de plus grande convenance que d’y associer la propre mère du Christ Jésus.
Réponses aux difficultés.
Au fondement de la corédemption : l’Immaculée Conception – Il est donc clair que la grâce de l’Immaculée Conception est la condition nécessaire de cette coopération unique de la Sainte Vierge à l’acte rédempteur du Christ. Marie ne pouvait être Corédemptrice qu’à la condition que sa Conception fût Immaculée. De la sorte, si on refuse cette condition, on refuse ce qui en dépend nécessairement. C’est pourquoi, tous les théologiens qui ont nié l’Immaculée Conception ont été conduits à nier également la corédemption universelle de Marie. La difficulté qui arrêtait ces théologiens ne nous arrête plus, et c’est la difficulté même de l’Immaculée Conception. Cette difficulté est résolue si l’on admet que pour racheter le genre humain tout entier, le mérite de Marie n’en découle pas moins du mérite du Christ, et que la grâce capitale reste le privilège exclusif de celui-ci. De manière semblable, notre charité est au principe méritoire de tous nos actes salutaires et néanmoins, cette charité découle elle-même de la charité du Christ et reste un don gratuit de Dieu[17]. En d’autres termes, on peut établir la similitude suivante : le rapport de la Très Sainte Vierge, première rachetée à la volonté rectifiée par la première grâce opérante est identique proportionnellement au rapport de la rédemption du genre humain tout entier accomplie par Marie avec le Christ à la volonté qui mérite sous la motion de la grâce coopérante.
Au fondement de la compassion : la Maternité divine.
Il est donc clair aussi que ni la souffrance ni la mort ne sont par elles-mêmes la cause suffisante de la rédemption ; celle-ci est d’abord un acte méritoire et l’immolation physique vaut dans la mesure où elle est offerte sous la motion de la charité. Le martyre lui-même tire sa valeur de l’acte de charité parfaite dont il découle. La Très Sainte Vierge Marie n’a pas enduré la souffrance physique du martyre, mais néanmoins sa charité surpassait celle de tous les martyrs réunis[18]. Ce degré unique de charité eût déjà suffit ; mais concrètement, la charité de Marie s’exerça, comme celle du Christ, dans l’endurance. Mère du Christ-Rédempteur, elle coopère à la Passion en souffrant comme seule une Mère peut souffrir de la douleur et de la mort de son propre Fils. Nous retrouvons là une exigence du mystère de l’Incarnation, et cette exigence pourrait expliquer la différence entre la corédemption proprement dite et la compassion. Marie peut nous racheter en union avec le Christ parce qu’elle est l’Immaculée Conception ; mais pour nous racheter, Marie souffre en union à la souffrance du Christ, et elle souffre ainsi d’une souffrance unique, parce qu’elle est la Mère de celui qui endure la Passion.
Au fondement de l’exemplarité : la Nouvelle Eve
Enfin, Marie agit aussi en tant que femme. Elle est associée au Christ dans l’œuvre de ce rachat du genre humain comme Eve fut associée à Adam dans l’œuvre de la perdition originelle. De la sorte, aux côtés du nouvel Adam, elle figure la nouvelle Eve : c’est ainsi toute la nature humaine qui est utilisée par Dieu pour accomplir l’œuvre du rachat[19]. De ce point de vue, la Très sainte Vierge, à l’instar du Christ, agit comme un exemple et un modèle. Cela reste vrai, à condition de ne pas omettre les deux aspects précédents.
Épilogue : la dévotion au Cœur Immaculé.
La dévotion au Cœur Immaculé et douloureux de Marie est l’expression adéquate de ces vérités théologiques. Le Cœur désigne l’amour surnaturel de la Très sainte Vierge, donc sa charité. Et ce Cœur Immaculé désigne la charité absolument unique de l’Immaculée Conception, condition indispensable de la Corédemption. Enfin le Cœur Immaculé et Douloureux désigne cette charité telle qu’elle s’exerce pour mériter dans l’acte d’une satisfaction corédemptrice unique, à travers la compassion d’une Mère. Tel est l’objet qui s’est imposé à la dévotion dans la sainte Église : il y a là un fait sans aucun doute providentiel. Ni la liturgie ni la piété populaire ne se sont reconnues aussi volontiers dans l’expression du Cœur de la Mère de Dieu, initialement propagée par saint Jean Eudes ; et à l’inverse, il est frappant de voir comment la dévotion s’est exprimée en recourant de préférence à cette expression du Cœur Immaculé et Douloureux de Marie, expression qui est la traduction aussi précise que possible du mystère de la Corédemption, tel que Dieu l’a révélé et confié à la Tradition de son Église.
source : Courrier de Rome n°652, avril 2022
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 3a, q. 49, a. 1, ad 3. « Par sa passion le Christ nous a délivrés de nos péchés par mode de causalité : la passion institue en effet la cause de notre libération, cause par laquelle peuvent être remis, à tout moment, n’importe quels péchés, présents ou futurs ; comme un médecin qui ferait un remède capable de guérir n’importe quelle maladie, même dans l’avenir ».[↩]
- Ibidem, ad 4. « La passion du Christ, nous venons de le dire, est comme la cause préalable de la rémission des péchés. Il est pourtant nécessaire qu’on l’applique à chacun, pour que ses propres péchés soient effacés. Cela se fait par le baptême, la pénitence et les autres sacrements, qui tiennent leur vertu de la passion du Christ, comme on le dira plus loin ».[↩]
- « Omnis satisfactio imperfecta in satisfactione perfecta fundatur » (Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 3a, q 1, art 2, ad 2).[↩]
- Col, II, 24.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 3a, q 48, art 5, ad 3. « Les souffrances des saints profitent à l’Église, non par mode de rédemption, mais à titre d’exhortation et d’exemple ».[↩]
- Ibidem, art 5. Il est propre au Christ et à lui seul d’être rédempteur.[↩]
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 3a, q 66, art 12. Le martyre ou baptême de sang est l’acte où l’on imite le mieux la passion du Christ.[↩]
- Saint Pie X, Ad diem illum, Solesmes, n° 233.[↩]
- « Dici merito queat ipsam cum Christo humanum genus redemisse » – Benoît XV : Sodalitati Nostrae Dominae a Bona Morte, du 2 mars 1918.[↩]
- Pie XII : Ad caeli reginam, Solesmes, n° 704.[↩]
- Voir à ce sujet le livre du père Terrien, sj, La Mère de Dieu et la Mère des hommes, 2e partie, livre 1er, chapitres 1–2. Saint Albert le Grand s’exprime ainsi dans son Mariale, question 150 : « Ut ipsam participem faceret beneficii redemptionis, participem esse voluit et poenae passionis, quatenus sic adiutrix redemptionis per compassionem, ita mater fieret omnium per recreationem : et sicut totus mundus obligatur Deo per suam passionem, ita et Dominae omnium per compassione ».[↩]
- C’est le raisonnement théologique sur lequel s’appuie le pape Pie XII dans l’encyclique Ad caeli reginam, Solesmes, n° 705.[↩]
- « Universis sanctitate praestat Maria conjunctioneque cum Christo atque a Christo ascita in humanae salutis opus de congruo ut aiunt promeret nobis quae Christus de condigno » (DS 3370).[↩]
- Pie IX, Ineffablis Deus du 8 décembre 1854, Solesmes, n° 43. « La Très Sainte Vierge Marie Mère de Dieu en prévision des mérites de Jésus-Christ Notre Seigneur et Rédempteur n’a jamais été soumise au péché originel ; mais elle a été entièrement préservée de la tâche d’origine et par conséquent rachetée d’une manière plus sublime (sublimiori modo redempta) ».[↩]
- RP Marie-Joseph Nicolas, op, « La Doctrine de la corédemption dans le cadre de la doctrine thomiste de la rédemption » dans : Revue thomiste de 1947, page 24.[↩]
- Ibidem.[↩]
- « Marie ne mérite pas sa propre charité. Mais le premier effet du mérite du Christ est d’obtenir à Marie la charité spéciale qui fait d’elle son associée dans l’œuvre de la rédemption. Ensuite avec elle il donne aux hommes ce qu’il lui a d’abord donné. C’est un peu ce qui se passe pour chacun de nous dans un ordre restreint et personnel. Ma première grâce est purement donnée. Elle est le pur effet du mérite et de la charité du Christ. Mais une fois justifié et avec le Christ qui demeure première cause du perpétuel soutien de ma grâce je contribue par mes actes personnels à mériter l’accroissement de cette première grâce et finalement la gloire éternelle à laquelle justement elle m’ordonne intrinsèquement. La différence ici est qu’il s’agit pour Marie d’obtenir non seulement sa béatitude personnelle mais encore la première grâce de tous les hommes » (RP Marie-Joseph Nicolas, art. cit. page 25).[↩]
- Cf 2a2ae, q 124, art 4, ad 1 : si on dit que la sainte Vierge a enduré le martyre au pied de la croix, cela doit s’entendre dans un sens impropre, et en raison d’une certaine similitude. L’expression de la Liturgie du 15 septembre établit la distinction entre l’acte objectif et la récompense qu’il mérite : c’est en particulier la Communion de la Messe : « Felices sensus beatae Mariae Virginis qui sine morte meruerunt martyrii palmam sub cruce Domini ». Il reste toujours possible de mériter dans l’ordre de la causalité morale l’effet correspondant à un acte que l’on n’aura pas soi-même posé dans l’ordre de la causalité physique, et tel est ici le cas de la Très Sainte Vierge par rapport au martyre. Même si elle n’est pas morte au pied de la croix, sa charité suréminente lui a permis d’obtenir le degré de gloire équivalent au martyre, et même davantage. On peut en dire autant par rapport au rachat des âmes : la Sainte Vierge n’a pas racheté les âmes au sens strict de la métaphore, dans la mesure où elle n’a pas satisfait en versant son sang comme l’a fait le Christ. Mais par sa compassion elle a mérité le même résultat que les souffrances et la mort corporelles du Christ produisaient selon l’efficience physique. Voir Terrien, op.cit. 2e partie, livre 3, chapitre 3, p. 226–232.[↩]
- « Pour que tout l’homme réparât, il fallait que dans l’accomplissement de l’œuvre même de la Rédemption il y eût l’homme et la femme, chacun jouant son rôle propre. C’est le mystère de la nouvelle Eve. L’idée d’associer la femme à l’homme dans l’œuvre de l’exaltation et du rachat de l’humanité est profondément liée avec celle de faire de l’homme lui-même selon toute sa nature le propre auteur de sa Rédemption » (RP Marie-Joseph Nicolas, art. cit. page 36).[↩]