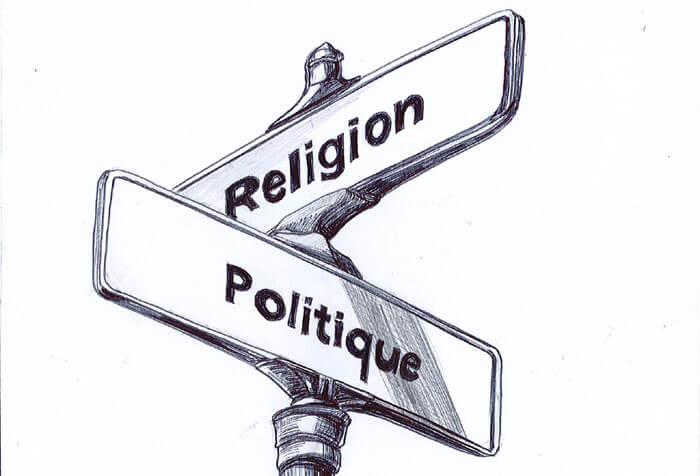Prologue
1 – Le Blog de la revue La Nef publie sur sa page du 5 juillet 2014 une étude du père Basile Valuet, osb, intitulée « Les malentendus d’Ecône sur la liberté religieuse » (abrégée ici en BV2). Cette étude est une réponse à l’article paru dans le numéro de mars 2014 du Courrier de Rome, lui-même intitulé : « Dignitatis humanae est contraire à la Tradition » (abrégée ici en CDR).
2 – Nous n’ignorions pas la personnalité du père Basile, ni l’étendue respectable de ses travaux. Nous avons seulement voulu dire ce que nous pensons de l’étude parue en juillet 2013 dans le Bulletin de Littérature ecclésiastique (abrégée en BV1) où le père Basile s’efforce de répondre aux « objections des lefebvristes » [1] ainsi qu’aux « trois principaux arguments de ceux qui nient la compatibilité de Dignitatis humanae avec la Tradition » [2]. Cette réponse se présente comme suffisante par elle-même, et nous l’avons donc prise comme telle [3]. D’autre part, nous admettons sans difficulté (et nous savions d’ailleurs déjà) que le père Basile a eu le loisir d’examiner en son temps les objections présentées par la Fraternité Saint-Pie X à l’encontre de la liberté religieuse (les Dubia rendus publics en 1987, ainsi que la réponse à la réponse faite par la CDF à ces mêmes), lesquelles ont été reprises et précisées lors des dernières discussions doctrinales de 2009–2011. Mais avec cela, il reste que les trois objections auxquelles le père Basile s’efforce de répondre dans l’étude de juillet 2013 « ne correspondent en rien à celles que la Fraternité Saint-Pie X a fait valoir jusqu’ici auprès du Saint-Siège » [4]. Il est toujours possible de se méprendre, même de très bonne foi, et même avec les meilleures informations ; pour dissiper la méprise, et laisser passer la lumière, il faut commencer par nettoyer la vitre, et des deux côtés. C’est dans cet esprit que nous entreprenons ici une nouvelle réflexion, pour éclaircir le débat soulevé par le père Basile. Nous reprendrons pour cela dans un deuxième temps les grandes articulations de l’analyse parue sur le Blog de La Nef. Mais auparavant, nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le point précis qui représente le véritable nœud de la difficulté.
1 – Le fond du problème
3 – Faut-il lire le Concile à la lumière de la Tradition ou la Tradition à la lumière du Concile ? Telle est la question. C’est une question fondamentale, car c’est celle de la méthode à suivre. Et c’est la question qui reste toujours pendante, entre le Saint-Siège et la Fraternité Saint-Pie X, depuis la fameuse Déclaration du 21 novembre 1974. Elle revient régulièrement à l’ordre du jour, et c’est faute d’y avoir répondu de façon suffisante que l’entente, tant espérée de part et d’autre, s’avère impossible. Sans compter que, refuser de poser la question, c’est déjà y avoir répondu, car c’est postuler que la seule lecture possible est celle que donne le magistère présent.
4 – La vérité est que le magistère transmet en les expliquant l’ensemble des vérités définitivement révélées par Dieu : il est l’organe de la Révélation publique, close à la mort du dernier des apôtres, et il l’est en tout temps. Cette transmission du dépôt de la foi se confond avec la Tradition, entendue au sens actif du terme. Cette Tradition, du fait qu’elle transmet la Révélation, est aussi bien le magistère présent que le magistère passé, et l’un et l’autre ne peuvent se contredire lorsqu’ils transmettent les mêmes vérités, entendues dans le même sens. Le magistère, étant la transmission de la Révélation, est tel aussi bien dans le passé que dans le présent : le fait d’être présent ou passé est accidentel au fait de transmettre la Révélation. Qu’il soit présent ou passé, le magistère se définit dans son acte comme l’enseignement toujours autorisé de la même Révélation.
5 – Si l’on réduit le magistère à son expression présente, tout se passe comme si ce magistère était l’organe non seulement de la Révélation mais aussi de la Tradition, l’une et l’autre s’inscrivant dans le passé. Dans une pareille optique, les vérités déjà proposées dans le passé sont en tant que telles l’objet du magistère, et il leur est accidentel d’avoir été déjà révélées par Dieu ou déjà proposées par le magistère d’hier. L’essentiel est que ces vérités aient déjà fait l’objet d’une proposition antérieure, car c’est à ce point de vue précis qu’elles sont l’objet formel du magistère. De la sorte, seul le magistère présent est magistère, puisque seul il transmet ce qui a déjà été proposé. Et il se distingue de la Tradition, puisque celle-ci est par définition une proposition déjà accomplie, une simple source, sujette à examen, et doit s’entendre seulement au sens objectif et non plus actif du terme. Ainsi, ce magistère présent réinterprète à chaque instant le magistère passé, parce que ce magistère passé en tant que passé, confondu avec la Tradition, est défini comme objet (et non plus acte) de transmission, d’explication et d’interprétation, au même titre que la Révélation.
6 – Ces deux visions sont incompatibles. La première correspond à la définition catholique et traditionnelle du magistère, et elle figure dans les deux constitutions Dei Filius et Pastor æternus du concile Vatican I. La deuxième correspond à une nouvelle définition du magistère, de tendance moderniste et évolutionniste, et elle figure dans le Discours du 22 décembre 2005 du pape Benoît XVI. Si l’on adopte la deuxième vision, la question que nous avons soulevée ne peut pas se poser. Car c’est le magistère de l’heure présente qui constitue l’unique critère à la lumière duquel il est possible de lire et le Concile et la Tradition, le Concile faisant en effet partie de la Tradition, du fait même qu’il s’inscrit désormais dans la proposition d’un magistère passé. Et c’est d’ailleurs pourquoi la lecture de Benoît XVI, avec son herméneutique d’un « renouveau dans la continuité », du fait même qu’elle appartient elle aussi au passé, doit à présent s’entendre à la lumière du magistère de François. En revanche, la question se pose si l’on adopte la première vision, et elle commence à se poser dès le moment même où se déroule le concile Vatican II, car un concile qui se met en contradiction avec les données essentielles de la Révélation, telle que le magistère les impose à notre adhésion, ne saurait représenter un critère de lecture autorisé. Nous sommes en effet fondés « à affirmer par des arguments tant de critique interne que de critique externe que l’esprit qui a dominé au Concile est l’esprit du libéralisme et du modernisme » [5]. Le dilemme soulevé ne consiste donc pas à opposer le magistère au magistère, celui d’hier à celui d’aujourd’hui. Il consiste à opposer le magistère, qui est la Tradition au sens actif du terme, et les enseignements du concile Vatican II, qui réclament une clarification, dans la mesure même où ils apparaissent incompatibles avec les données de la Révélation suffisamment proposées par le magistère.
7 – Dès le début de son étude, le père Basile cite une lettre du cardinal Seper adressée à Mgr Lefebvre :
L’affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs qui, face aux excès de l’étatisme et aux totalitarismes modernes, ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l’enseignement du magistère et, bien qu’il ne soit pas l’objet d’une définition, il réclame docilité et assentiment.
BV1, p. 290.
Par cette citation, qui prend sous sa plume la valeur d’un argument d’autorité, le père Basile répond déjà à la question fondamentale, car le propos du cardinal préfet de la CDF adopte implicitement la nouvelle définition du magistère. Il est clair qu’à partir d’une pareille réponse, nous ne pourrons plus nous entendre sur rien. Il serait donc inutile de pousser la discussion plus loin. En effet, il s’agit pour le père Basile de manifester, au moyen de la recherche théologique, comment Dignitatis humanae est en continuité avec la Tradition, cette continuité étant présupposée d’avance, en raison de la docilité que réclament les enseignements du concile Vatican II, dont la valeur magistérielle ne saurait faire de doute. Alors qu’il s’agit pour nous de dénoncer les insuffisances graves d’un texte qui, dans ses lignes de fond, reste incompatible avec les données certaines de la Révélation et ne saurait bénéficier pour autant d’aucune valeur magistérielle.
8 – Nous voudrions cependant reprendre, dans l’intérêt de nos lecteurs, les principaux points de la réponse qui nous a été faite. Et nous en examinerons la portée à la lumière de la Tradition, sainement comprise.
2 – « Le magistère antérieur et postérieur à D.H. »
9- Nous mettons ce titre entre guillemets, car l’expression utilisée par le père Basile [6] véhicule sa propre problématique fausse.
2.1 – Pie IX et Quanta cura
10 – Nous nous sommes appuyés sur le passage de Quanta cura qui condamne le faux droit à ne pas être empêché, adopté par DH [7]. La proposition condamnée est la suivante :
La meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la paix publique le demande.
DS 1689.
Le père Basile nous objecte que « c’est une erreur de penser que les violatores en question sont per se ceux qui ne respectent pas intégralement les lois de Dieu et de l’Église, et en particulier, tous les non-catholiques, tous ceux qui vivent dans l’erreur ou la propagent » [8].
Autrement dit, l’exercice public d’une religion fausse n’étant pas en tant que tel une violation physique de la religion catholique, l’affirmation de DH 2 (revendiquant pour tout homme le droit de ne pas être empêché par quelque pouvoir humain que ce soit d’exercer en public comme en privé sa religion, catholique ou non, dans de justes limites) ne tomberait pas sous le coup de la condamnation de Quanta cura. Cette objection du père Basile limite de manière fausse la portée de la condamnation de Pie IX : en effet, celui-ci envisage d’abord et avant tout une violation non point seulement physique mais morale, c’est à dire telle que la subit la religion catholique du simple fait que les fausses religions s’exercent publiquement. La prière faite dans une mosquée ou dans une synagogue, le culte célébré dans un temple protestant ou dans une église orthodoxe, même s’ils se déroulent sans causer aucun trouble physique, représentent toujours en tant que tels une violation morale de la religion catholique, ainsi qu’un préjudice spirituel et un scandale pour tous les citoyens. En dépit de ce que nous objecte le père Basile, la contradiction entre Quanta cura et DH est immédiate et manifeste : pour Quanta cura, la norme est la répression du culte public des fausses religions, même limité par les exigences de l’ordre public ; pour DH, la norme est la liberté du culte public des fausses religions, tel que limité par les exigences de l’ordre public. Cela s’explique parce que, pour Pie IX, le culte public d’une fausse religion est, en tant que tel, une atteinte portée à l’ordre public juste objectif, c’est à dire à la paix publique, atteinte qui reste toujours d’ordre moral, même si elle n’est pas toujours d’ordre physique. En effet, il est impossible d’exercer une fausse religion sans porter atteinte à la paix publique, puisque la première condition de la paix publique est l’exercice pacifique de l’unique vraie religion, non concurrencé par le scandale des faux cultes. Or, même s’il est limité par les exigences seulement physique de la paix, par exemple parce que nul n’a le droit de prier publiquement, à partir du moment où il en résulte un tapage nocturne, le droit à la liberté religieuse est illimité dans le domaine religieux, puisque tous les adeptes de toutes les religions ont le droit de prier publiquement, à partir du moment où cela n’entraîne aucun tapage nocturne. Pour surmonter la contradiction qui oppose irrémédiablement Quanta cura et DH, il faudrait soutenir que l’exercice public d’une religion fausse dans le cadre de l’ordre social ne saurait violer moralement la religion catholique, et donc sous-entendre que l’ordre social temporel est autonome par rapport au droit positif divinement révélé et que la paix publique peut subsister malgré l’indifférentisme religieux des pouvoirs publics. Tel est le principe d’autonomie, énoncé par le n° 36 de Gaudium et spes, et revendiqué par Benoît XVI comme au fondement de la liberté religieuse [9]. Mais ce principe faux est condamné par le pape saint Pie X : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur » [10], puisque « la civilisation n’est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c’est la civilisation chrétienne, c’est la cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété » [11].
2.2 – Léon XIII
11- Léon XIII dit : « L’homme a dans l’État le droit de suivre, d’après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d’accomplir ses préceptes sans que rien puisse l’en empêcher » [12]. Ex conscientia : peu importe la traduction française, du moment que l’on comprend que la préposition latine suivie de l’ablatif désigne ici non pas la véritable cause du droit, mais sa simple condition. Car le fondement de ce droit demeure objectif. Le droit n’est pas d’abord celui de remplir la condition. Il est d’abord celui d’accomplir la volonté divine et son précepte, moyennant cette condition.
12 – DH 3 dit :
« C’est par sa conscience que l’homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine ; c’est elle qu’il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités, pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d’agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse ».
Le père Basile commente : « S’il est clair qu’on ne peut avoir le droit affirmatif que d’accomplir la vraie volonté de Dieu (et non ce que la conscience erronée prendrait pour tel), il s’agit néanmoins de savoir ce qui se passe lorsque l’homme abuse de ce droit affirmatif en suivant une conscience erronée : garde-t-il l’usage de ce droit, en sorte qu’un droit négatif le protège ? Léon XIII ne répond pas à cette question, et il faudra attendre un siècle de réflexion des théologiens et juristes catholiques, ainsi que du magistère, pour arriver à la réponse magistérielle complète. En attendant, pour le savoir, il fallait donc se référer à la philosophie générale du droit traditionnelle en milieu catholique. […] Cette philosophie traditionnelle […] nous enseigne que l’abus d’un droit n’en enlève pas nécessairement l’usage. Il faudra donc que l’Église précise encore quand un abus de ce droit à la vraie liberté de la conscience reconnu par Léon XIII est non seulement moral, mais aussi juridique, et peut – voire doit – donc être réprimé, et quand cet abus moral n’est pas juridique et ne peut donc pas être réprimé. C’est ce qu’elle fera en DH 7, § 3 » [13]. Sans doute est-il vrai que « l’abus d’un droit n’en ôte pas l’usage ». Mais ici, une distinction s’impose. L’objet du droit demeure en effet, même si certains en abusent : par exemple, le droit demeure sauf, pour tout honnête homme, de la liberté physique de ses mouvements, même si les voleurs et les criminels en abusent. En revanche, le sujet qui abuse de son droit le corrompt et le détruit par le fait même, et peut en être privé, dans la mesure même où il en abuse. C’est ainsi que les voleurs et les criminels méritent d’être emprisonnés. De la sorte, celui qui agit contrairement à la volonté de Dieu, même en suivant une conscience erronée, abuse du droit qu’il a d’agir sans contrainte, au for public externe. Par suite, il mérite d’être privé de ce droit et donc d’être empêché d’agir de façon contraire à la volonté de Dieu, même si pour lui comme pour tous les autres hommes reste sauf l’usage du droit d’agir sans contrainte au for externe public, afin de suivre la volonté de Dieu.
Ajoutons que du point de vue de l’objet, il ne saurait y avoir de droit que pour agir conformément à la volonté de Dieu ou pour ne pas être contraint à agir contre sa conscience. Mais il n’y a aucun droit à agir selon sa conscience, en tant que telle, droite ou erronée. Quant à dire que suivre une conscience erronée est un abus du « droit de suivre sa conscience », c’est peut-être ce qu’affirme Vatican II. Mais ce n’est pas du tout ce qu’affirme Léon XIII. Et cela reste à démontrer, à partir de ce qu’enseigne le magistère. L’on ne saurait en tout cas s’appuyer sur ce que dit Léon XIII pour justifier ce que dit Vatican II. DH ne peut donc trouver aucun fondement ni dans Libertas, ni dans Immortale Dei.
2.3 – Pie XI
13- Il est inutile de revenir en détail sur le passage de l’Encyclique Mit brennender Sorge de Pie XI, où le père Basile croit découvrir la justification des enseignements de DH. Toute l’analyse qu’il donne de ce texte est radicalement faussée, du fait que Pie XI y parle très précisément non du sujet mais de l’objet du droit, lequel ne saurait donc être que le droit d’exercer la seule vraie religion, c’est à dire celle des catholiques. Par conséquent, Pie XI veut dire qu’en matière religieuse, le seul droit d’expression possible, dans la ligne de la loi naturelle, est le privilège exclusif de la vraie religion et partant (si l’on veut passer de l’objet au sujet du droit) des seuls catholiques. Plus exactement, s’il est question du droit de tous les hommes et de tous les croyants, l’on peut dire, en effet, que tout homme a le droit naturel d’exercer la religion, mais à condition d’entendre par là la religion catholique, qui est la seule vraie. En définitive, cela revient à dire que tout homme a seulement le droit d’être catholique. Le pape dit en effet :
« Ne croit pas en Dieu celui qui se contente de faire usage du mot Dieu dans ses discours, mais celui-là seulement qui à ce mot sacré unit le vrai et digne concept de la Divinité ».
Or, seul celui qui professe la foi catholique remplit cette condition. De ce fait, le père Basile ne peut s’appuyer sur ce passage pour justifier la liberté religieuse de DH.
2.4 – Pie XII
14 – Le père Basile [14] conteste l’explication que nous avons donnée du passage de l’Allocution Ci riesce du 6 décembre 1953. Pie XII y dit en effet que « dans certaines circonstances il n’y a aucun droit d’interdire le mal et l’erreur ». Et le contexte semble indiquer que ce propos doive concerner seulement les individus en tant que tels, non les pouvoirs publics. Au demeurant, quand bien même l’affirmation de Pie XII concernerait aussi ces derniers, il s’agit tout au plus d’un devoir de tolérance, et d’un devoir qui, loin d’être universel et nécessaire, s’impose seulement en raison de certaines circonstances. Par exemple, c’était un devoir, pour le roi de France, à la fin du seizième siècle, de tolérer la pratique du calvinisme dans son royaume, car ne pas le faire n’aurait fait qu’aggraver une guerre civile déjà désastreuse. Mais cela n’impliquait nullement un quelconque droit à l’immunité de toute contrainte, de la part des protestants. C’est pourquoi, même si l’on admet que, parlant à des juristes, et donc aux représentants du pouvoir civil, Pie XII envisage le devoir des autorités, et pas seulement celui des individus, on ne saurait déduire de ses propos un argument en faveur de la liberté religieuse. Le sophisme du père Basile consiste à passer indûment du devoir (circonstancié et relatif) de tolérer au droit (universel et absolu, limité seulement par accident) à l’immunité. Il est sans doute exact qu’à tout devoir correspond un droit, mais la correspondance envisagée ici par le défenseur de DH n’est pas juste. Si les pouvoirs publics ont, dans certaines circonstances, le devoir de tolérer les adeptes des religions fausses, il n’en résulte pas que ces derniers soient détenteurs d’un droit naturel qui serait au fondement du devoir de tolérer. Car la tolérance s’explique toujours, en tant que telle, en raison d’un mal plus grand à éviter. C’est pour éviter ce mal plus grand (la guerre civile) que l’autorité s’abstient de réprimer, provisoirement, un mal moindre (l’exercice public du culte protestant). Ce mal, quoique moindre, reste un mal et, loin de fonder un quelconque droit à la tolérance, mérite normalement la répression. Ce qui fonde le droit à la tolérance ne saurait être qu’un bien, et c’est précisément le bien d’un tiers, qui serait compromis, par accident, à cause de la répression. Cette compromission du bien d’un tiers représente en effet en certains cas un mal pire que le mal qui appellerait normalement la répression. C’est ainsi qu’une épouse digne et innocente a le devoir de tolérer son mari qui la trompe ou qui la bat ; mais ce devoir ne s’explique pas du tout parce que son mari aurait un droit à l’immunité, le droit naturel de ne pas être empêché de tromper ou de battre son épouse. Cela s’explique en raison du bien supérieur de l’unité de la famille, qui, s’il était compromis, entraînerait des conséquences graves pour les enfants. La séparation des époux représente en l’occurrence un mal pire, car opposé au plus grand bien de l’éducation, auquel les enfants ont droit. C’est ce droit des enfants qui est au fondement du devoir qui oblige l’épouse à tolérer l’époux indigne.
15 – Le père Basile écrit pourtant que si l’autorité avait toujours le droit de réprimer l’erreur, « alors, on commettrait une injustice envers celui qui est dans l’erreur, en l’empêchant de pratiquer son erreur. C’est donc que cet adepte de l’erreur, ces circonstances, serait couvert par un droit, tout comme les parents infidèles qui éduquent leurs enfants dans l’erreur religieuse » [15]. Comme nous venons de le montrer, s’il y a une injustice, ce ne peut être que celle dont pâtissent des tiers, en l’occurrence les autres citoyens, dont la paix serait empêchée si les pouvoirs publics entreprenaient de réprimer l’erreur, au prix d’une guerre civile. Mais il n’y aurait aucune injustice vis-à-vis de celui qui est dans l’erreur, car celui-ci ne possède aucun droit à la non-répression. De manière comparable, si l’Eglise n’empêche pas les parents infidèles d’exercer leur autorité sur leurs enfants, et renonce donc à exiger que ces derniers soient baptisés, ce n’est pas parce que ces parents auraient le droit naturel à ne pas être empêchés d’élever leurs enfants dans l’infidélité, mais c’est en raison du droit naturel qu’ont les enfants de recevoir de leurs parents tous les biens de la nature, comme ceux de la grâce. Ainsi que l’explique Cajetan [16], même s’il est vrai que les biens de la nature, avec l’éducation parentale qui les procure, ne sont pas un bien supérieur par rapport aux biens de la grâce, il reste aussi que l’ordre de la grâce doit s’accomplir sans violenter celui de la nature. Voilà pourquoi l’Eglise tolère les parents infidèles, en tant qu’infidèles, dans l’intérêt de leurs enfants, dans la stricte mesure où la sauvegarde de cet intérêt passe par le respect de l’ordre naturel. Le sophisme du père Basile – et de tous les défenseurs de DH – consiste à passer du devoir de tolérer au droit à l’immunité, comme si le premier présupposait nécessairement le second.
2.5 – Jean-Paul II et Benoît XVI
16 – Nous avons montré que le magistère post-conciliaire de Jean-Paul II et Benoît XVI « revendique la liberté religieuse comme un droit positif d’expression, c’est-à-dire comme le droit d’exercer pour elle-même la religion que l’on tient pour vraie et pas seulement le droit à l’absence de toute coercition de la part des pouvoirs civils » [17]. Le père Basile se contente de nier la réalité de ce fait. Selon lui, dans les textes que nous avons cités, Jean-Paul II ne parlerait jamais du « droit », mais seulement de la « liberté » de faire ou d’agir. Or, cela est tout simplement faux. Le texte que nous avons cité dit littéralement : « Le 1er septembre 1980, en m’adressant aux chefs d’État signataires de l’Acte final d’Helsinki, j’ai tenu à souligner – entre autres – le fait que la liberté religieuse authentique exige que soient garantis aussi les droits qui résultent de la dimension sociale et publique de la profession de foi et de l’appartenance à une communauté religieuse organisée. […] De même ceux qui adhèrent aux diverses religions devraient – individuellement et en communauté – exprimer leurs convictions et organiser le culte ainsi que toute autre activité particulière en respectant aussi les droits des autres personnes qui n’appartiennent pas à cette religion ou qui ne professent pas un credo » [18]. Le père Basile prétend pareillement que le texte de Benoît XVI cité par nous [19] parle non pas de « droit » mais de « liberté » d’agir. Là encore, c’est tout simplement faux. Le père Basile évite de donner l’intégralité de la citation que nous avons faite et se contente d’en produire un passage qui pourrait aller à l’appui de ses dires. Mais il suffit de lire dans son entier le texte que nous avons cité, pour s’apercevoir sans peine que Benoît XVI y parle explicitement d’un droit et d’un droit positif : « Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. Elle ne devrait pas rencontrer d’obstacles si elle désire, éventuellement, adhérer à une autre religion ou n’en professer aucune. […] La règlementation internationale reconnaît ainsi aux droits de nature religieuse le même status que le droit à la vie et à la liberté personnelle, car ils appartiennent au noyau essentiel des droits de l’homme, à ces droits universels et naturels que la loi humaine ne peut jamais nier » [20]. Nous ne pouvons donc qu’inviter le père Basile à relire attentivement ces citations.
3 – L’objet du droit à la liberté religieuse
17 – Pour justifier sa position, le père Basile fait état des considérations de Dom Baucher, dans le Dictionnaire de théologie catholique : « En décrétant cette tolérance, le législateur est censé ne pas vouloir créer au profit des dissidents le droit ou la faculté morale d’exercer leur culte, mais seulement le droit de n’être pas troublés dans l’exercice de ce culte. Sans avoir jamais le droit de mal agir, on peut avoir le droit de n’être pas empêché de mal agir, si une loi juste prohibe cet empêchement pour des motifs suffisants » [21]. Cette réflexion est sans doute intéressante, mais elle est mal comprise par le père Basile. Dom Baucher ne pose en principe aucun droit naturel à ne pas être empêché, mais envisage seulement un droit civil, qui serait la conséquence d’une loi édictée en vue du bien commun et pour tenir compte du droit des autres à la paix sociale. Avant que cette loi fût édictée, les dissidents n’avaient aucun droit, ni naturel, ni civil ; après promulgation de la loi de tolérance, on peut parler (avec toutes les précautions que réclame l’analogie) d’un « droit civil », dans la mesure où cette loi exige d’être respectée, en ce qu’elle accorde l’immunité. Le droit est donc formellement, ici comme toujours, celui du législateur, dont les mesures réclament leur mise en application ; et on l’attribue seulement comme à son effet (pris au sens d’une « finis cui ») aux dissidents qui ne sont pas empêchés, dans la mesure où ils doivent bénéficier de la décision prise par l’autorité.
18 – Le père Basile revient ensuite sur la question des parents infidèles. « Les papes du XIXe siècle », dit-il [22], « tout en refusant une liberté de l’erreur ou du mal objectifs, c’est-à-dire un droit affirmatif à l’erreur, connaissaient et professaient par ailleurs un droit des parents infidèles à ne pas être empêchés d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses, pourtant fausses, un droit de propriété, même pour ceux qui usent mal de ce droit, un droit même pour les pécheurs – que tous les hommes sont – à ne pas être tués (tant qu’on est innocent de crime), etc. Par conséquent, tout en refusant la liberté comme droit affirmatif d’agir mal, ils ne la refusaient pas toujours comme un droit négatif protégeant même un agir erroné mauvais ». Là encore, le père Basile se méprend sur la véritable portée des enseignements de saint Thomas, repris par les papes Pie IX et Léon XIII. Saint Thomas n’envisage pas un instant un droit des parents à la liberté de l’éducation, y compris en matière religieuse. Il considère que, en tant que tels, les enfants dépendent par nature (ou en vertu du droit naturel) de la raison de leurs parents. Si droit il y a, il s’agit donc du droit des enfants à recevoir de la raison de leurs parents tous les dons de la nature et de la grâce. Et cela doit s’entendre toutes choses égales par ailleurs, c’est à dire étant supposé que les parents accomplissent leur devoir en conformité avec l’intégrité du plan divin. C’est ici que la remarque de Cajetan est éclairante : « Deux points de vue s’observent chez les parents non-chrétiens : d’une part, ils ont pour eux le droit naturel, qui leur confie le soin de leurs enfants et d’autre part, ils y ajoutent leur infidélité, qui les conduit à élever ces enfants dans une fausse religion. Le deuxième point de vue est celui d’un mal : à cet égard, ces parents pèchent mortellement et méritent pour cela d’être privés non seulement de leurs enfants, mais de leur propre vie et il serait juste de les faire disparaître ». Les parents n’ont donc aucun droit négatif à l’immunité. « Cependant, le premier point de vue est celui d’un droit naturel. C’est pourquoi, Dieu, lorsqu’il établit l’ordre surnaturel, pour qu’il perfectionne l’ordre naturel, ne veut pas que soit violé le droit naturel, bien que ceux qui abusent de ce droit méritent d’en être privés » [23]. Les enfants gardent tout leur droit à recevoir de leurs parents ce que Dieu veut leur accorder par leur entremise, les biens de la nature comme ceux de la grâce. Quand bien même les parents contrediraient ce droit en s’opposant aux biens de la grâce, leurs enfants conservent encore le droit de recevoir d’eux les biens de la nature. En effet, même s’il est vrai que ces biens de l’ordre naturel ne représentent pas un bien supérieur par rapport à ceux de l’ordre surnaturel, il reste qu’ils leur sont nécessairement liés, comme le perfectible l’est à la perfection, même gratuite. Est donc tolérée la mauvaise manière dont les parents remplissent leur devoir, pour sauvegarder le droit que possèdent leurs enfants à recevoir d’eux tout uniment et la nature et la grâce. Mais en tout cela, on ne trouve nulle trace, ni chez saint Thomas, ni chez Cajetan, d’un droit à l’immunité pour les parents.
19 – Le père Basile [24] nous reproche ensuite de « croire que la proclamation d’un droit négatif (droit à ne pas être empêché d’agir) implique la proclamation d’un droit affirmatif (droit à agir) », alors que, selon lui, « c’est seulement la réciproque qui est vraie ». Il nous reproche aussi de méconnaître « les lois de la contraposition logique, et de croire que « la condamnation d’un droit affirmatif entraîne celle d’un droit négatif ». Nous n’avons rien écrit de tel, et il suffit de relire notre propos, dont le père Basile donne d’ailleurs la citation en note, pour s’en rendre compte. Nous avons écrit : « Il est bien difficile de séparer le droit à la liberté religieuse tel que le conçoit exactement Vatican II et le droit à la diffusion de l’erreur, car celui-là appelle et contient inévitablement celui-ci » [25]. Nous nous sommes placés au niveau des faits, comme l’indique un peu plus loin un autre passage de notre étude, que le père Basile omet de citer : « Le droit négatif à ne pas être empêché correspond dans les faits au droit positif de diffuser l’erreur. Sur ce point, la meilleure explicitation du droit énoncé par le Concile se trouve dans le magistère postérieur. Car celui-ci revendique la liberté religieuse comme un droit positif d’expression, c’est à dire comme le droit d’exercer pour elle-même la religion que l’on tient pour vraie et pas seulement le droit à l’absence de toute coercition de la part des pouvoirs civils » [26]. Nous ne disons donc pas d’abord, comme pour énoncer une règle de contraposition logique et une vérité absolument universelle, que « tout droit négatif implique un droit affirmatif », pour faire ensuite l’application de cette loi au cas précis de Vatican II. Nous nous contentons d’observer ce qu’il en est précisément dans le cas unique et singulier de ce 21e concile œcuménique. S’il fallait rappeler un principe universel, ce serait plutôt celui d’après lequel, et conformément à ce qu’enseigne la saine théologie catholique, tout acte moralement mauvais encourt ce que saint Thomas appelle un « reatus poenae », c’est à dire l’obligation morale de subir une peine, et que par conséquent nul acte moralement mauvais ne saurait faire l’objet d’un droit, ni positif, pour s’exercer, ni même négatif, pour ne pas être empêché de s’exercer. Le seul « droit » que mérite un pareil acte est d’être empêché ou puni. Et ce « droit », ou, plus exactement, ce « reatus poeneae » est métaphysiquement incompatible avec le droit à l’immunité, puisqu’il en est le contraire absolu. D’autre part, si l’on ne saurait dire que tout agir moralement bon est l’objet d’un droit, en revanche, on doit bien reconnaître que l’objet d’un droit (négatif comme positif) est toujours un agir moralement bon. Si donc l’on revendique un droit négatif à ne pas être empêché d’agir, l’agir en question est implicitement défini comme un agir moralement bon. Et si cet agir est tel, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse aussi l’objet d’un droit positif, droit d’agir et pas seulement d’être empêché d’agir. Et ce sont les faits qui prouvent qu’il en va bien ainsi, dans le cas précis de la liberté religieuse : de l’aveu même de Jean-Paul II et de Benoît XVI, celle-ci fait l’objet d’un droit non seulement négatif mais encore positif, et cela suppose que l’exercice public d’une religion fausse est un acte moralement bon. Le sophisme du père Basile consiste donc à raisonner comme si un agir moralement mauvais (comme l’est la profession publique d’une religion fausse) pouvait faire l’objet d’un droit, pourvu que ce droit fût toujours seulement négatif et jamais positif. Nous lui demandons alors de nous expliquer comment un acte moralement mauvais pourrait faire l’objet d’un droit, et, qui plus est, d’un droit naturel, ne serait-il que négatif. Et s’il reconnaît, avec la saine théologie catholique, que nul acte moralement mauvais ne saurait être objet d’un droit, qu’en déduit-il au nom des règles de la contraposition logique ?
20 – Traitant de l’exercice et de l’abus du droit [27], le père Basile rappelle que le droit naturel enseigné par DH est celui de ne pas être empêché de diffuser la religion que l’on croit en conscience vraie. Notre auteur précise à cette occasion que l’homme possesseur de ce droit peut sans doute avoir une conscience erronée, mais, ajoute-t-il, si quelqu’un n’est pas empêché de diffuser l’erreur ou de faire le mal, il y aurait seulement là un abus du droit à la liberté religieuse. Et, pour s’en tenir à ce qu’enseigne DH 2, § 2, cet abus du droit ne ferait pas perdre l’usage du droit. Mais n’est-ce pas jouer sur les mots et introduire la confusion ? Car enfin, même si l’homme est le sujet habilité à user d’un droit, un droit ne saurait porter comme sur son objet que sur le vrai et le bien, et non pas sur ce que la conscience présente comme tel. S’il est vrai que nul ne peut agir à l’encontre de sa conscience, il y a là seulement une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que cette action soit bonne et puisse ainsi faire l’objet d’un droit [28]. Il faut encore que la conscience se règle elle-même sur la loi divine, naturelle et positive. Dire que nul ne peut agir à l’encontre de sa conscience n’implique nullement que chacun possède le droit de ne pas être empêché d’agir selon sa conscience, car si celle-ci est erronée, l’action est mauvaise et ne peut faire l’objet d’aucun droit. Lorsque la conscience erronée n’est pas empêchée de professer publiquement sa religion fausse, cette situation équivaut non pas à l’abus mais à la corruption ou à la destruction du droit. En effet, seule la vraie religion peut faire l’objet d’un droit, tandis qu’une religion fausse, même considérée comme vraie par une conscience erronée (fût-elle même invincible dans son erreur) peut tout au plus faire l’objet d’une tolérance, mais jamais d’un droit proprement dit.
21 – Le père Basile écrit plus loin que « si le droit à la liberté religieuse protège celui qui pratique une erreur, en impliquant que l’adepte de l’erreur garde le droit à l’immunité, cela est accidentel à la définition de ce droit » [29]. En bonne logique, une conséquence est accidentelle à un principe lorsqu’elle n’en procède pas, mais survient comme de l’extérieur, c’est à dire pour une autre raison. Par exemple, en tant que tel, le droit des parents à éduquer leurs enfants n’implique pas l’enseignement d’une religion fausse, car celui-ci survient pour une autre raison, non pas parce que les parents sont les parents, mais parce que, dans tel cas particulier, tels parents se trouvent être des infidèles. En revanche, la liberté religieuse, telle que l’enseigne Vatican II, est définie comme le droit de ne pas être empêché de pratiquer non pas seulement la vraie religion, mais toute religion que la conscience regarde comme vraie ; du fait même de cette définition, si l’adepte de l’erreur garde le droit à l’immunité, cela est bel et bien une conséquence non pas accidentelle mais essentielle au principe de la liberté religieuse, tel que l’enseigne DH.
22 – Le père Basile en vient enfin à l’objection qu’il voudrait faire à notre étude [30]. Selon lui, nous aurions tort « de penser que DH accorde par principe la liberté à l’erreur. En effet, DH ne revendique pas spécifiquement de droit pour les non-catholiques comme tels. DH ne parle jamais précisément des religions non catholiques, et ne revendique directement ni pour elles ni pour leurs adeptes comme tels aucun droit, pas même de droit négatif. […] En effet, DH accorde la liberté par principe aux personnes humaines ; ensuite, que ces personnes pratiquent et diffusent l’erreur, c’est accidentel : c’est un abus de leur droit à la liberté. Cet abus, extrinsèque à la religion comme telle et au droit défini par DH, se trouve protégé par le droit, ce n’est pas per se, mais per accidens ». Redisons encore ici que la personne humaine est seulement le sujet, non l’objet du droit. Si l’on s’imagine que l’on évite de dire que DH accorde la liberté à l’erreur, sous prétexte que le droit à la liberté n’est accordé qu’aux personnes, c’est se payer de mots. De toutes façons, oui : qui d’autre que la personne humaine pourrait être le sujet d’un droit ? Mais ce n’est pas le sujet d’un droit qui définit celui-ci dans sa nature, en lui donnant son espèce. C’est son objet. Or, DH revendique le droit de ne pas être empêché d’exercer publiquement la religion que la conscience regarde comme vraie : c’est là l’objet de ce droit, et c’est donc comme tel l’exercice public de toute religion, vraie ou fausse, pourvu qu’elle soit tenue pour vraie par la personne qui la professe. DH accorde ainsi la liberté, certes, aux personnes comme au sujet du droit ; mais DH accorde aussi et surtout la même liberté aussi bien à la vérité qu’à l’erreur, comme à l’objet du droit. Par conséquent, si les personnes, sujet du droit, pratiquent et diffusent l’erreur, cela est essentiel au droit, car cela est son objet. Et le droit protège cette diffusion de l’erreur non point par accident mais par soi. Tous les développements du père Basile n’y changeront rien.
4 – Le fondement du droit à la liberté religeuse
23 – Le père Basile nous reproche encore ici [31] de méconnaître l’adage selon lequel l’abus n’enlève pas l’usage du droit. Mais cela suppose qu’il y ait en effet un véritable droit. Il est clair que l’objet d’un droit (par exemple l’exercice de la vraie religion) demeure toujours tel, quand bien même les sujets de ce droit en useraient mal (par exemple de mauvais prêtres, qui pratiqueraient la simonie). Mais l’exercice public d’une fausse religion ne saurait faire l’objet d’un droit, quand bien même ceux qui exercent cette religion fausse la regardent comme vraie à cause d’une conscience erronée. Le père Basile nous objecte aussi que lorsqu’un homme déchoit de sa dignité morale, il abuse de son droit mais ne le perd pas pour autant. Nous disons pour notre part que la dignité de la personne humaine est une dignité ontologique, qui se dit sur le plan de l’être et qui est donc antérieure à toute action. Elle ne peut donc fonder un droit à l’immunité qui ne saurait être que postérieur à l’action. Ce qui fonde un devoir et un droit de poser une action bonne, c’est la nature humaine, telle qu’elle se prend concrètement en dépendance de sa fin, celle-ci étant d’ordre surnaturel.
24 – Le père Basile revient ensuite sur l’argument qu’il croit pouvoir déduire du commentaire de Cajetan sur le passage cité de saint Thomas (à propos du baptême des enfants nés de parents infidèles). Nous renvoyons ici à ce que nous avons dit plus haut, en notre n° 18. Ajoutons simplement que ni saint Thomas ni Cajetan ne donnent aucun argument en faveur d’un droit à l’immunité. Ils expliquent seulement qu’il serait contraire au droit naturel d’administrer le baptême aux enfants contre le gré de leurs parents. Il y a là l’application particulière d’un principe général, selon lequel nul ne peut être contraint par la violence à embrasser la vraie religion : l’enfant étant comme tel ordonné à Dieu par l’intermédiaire de la propre raison de ses parents, faire violence à ceux-ci équivaut à lui faire violence. Mais il n’en résulte nullement (et ni saint Thomas ni Cajetan ne veulent dire) que les parents auraient le droit de ne pas être empêchés d’inculquer une religion fausse à leurs enfants. Et si l’Eglise ne les en empêche pas, elle se contente de tolérer ce qui reste un mal, mais un mal moindre par rapport au mal pire que représenterait le non-respect du droit naturel. Ce droit naturel exige que l’on passe par l’intermédiaire des parents pour dispenser aux enfants les biens de la nature et de la grâce. Mais c’est tout : si les parents ont un droit naturel à ce rôle d’intermédiaire et ne doivent donc pas être empêchés de le jouer, ce rôle n’a de sens que pour dispenser aux enfants les seuls biens que Dieu a prévu de leur donner, ceux de la nature et de la grâce. A ce sujet, la remarque suivante de saint Thomas est éclairante : « Procurer aux enfants des infidèles les sacrements du salut revient à leurs parents. Il y a donc pour eux péril si, en soustrayant leurs petits enfants aux sacrements, il en résulte pour ceux-ci un détriment en ce qui concerne le salut » [32]. Cela prouve bien que les parents n’ont aucun droit (ni positif ni négatif) pour donner à leurs enfants ce qui serait contraire aux biens de la grâce.
5 – Le but du droit à la liberté religieuse
25 – Le père Basile nous reproche [33] de croire que « le but principal de la liberté religieuse selon DH serait d’agir selon sa conscience, la question de l’erreur n’important pas ». Selon lui, le vrai sens de DH serait que le but principal de la liberté religieuse est « de mettre l’homme dans les meilleures conditions pour accomplir son obligation (individuelle et collective) de suivre sa conscience et adhérer à l’unique vraie Église », le but du droit dont parle DH étant d’adhérer à la vérité en le faisant selon sa conscience. Il suffit de nous relire [34] pour s’apercevoir que, loin d’avoir dit cela, nous nous sommes efforcés de rendre un compte aussi exact que possible de la pensée de DH. Et nous avons ainsi montré que celle-ci est contradictoire : comment en effet l’homme pourrait-il accomplir ses devoirs envers Dieu et adhérer à l’unique vraie Eglise dans une société où règnerait l’indifférentisme religieux et où toute religion, vraie ou fausse, jouirait de l’immunité ? Si l’homme a le devoir d’adhérer à la vraie religion, ce devoir ne peut s’accomplir qu’en conformité avec la nature sociale de l’homme, qui découle justement de sa nature raisonnable et libre. DH prétend que l’homme puisse adhérer à la vérité conformément à ce qu’exige sa nature raisonnable et libre, mais au rebours de ce qu’exige sa nature sociale. Et de fait, conformément à la nature sociale de l’homme, la mise en application officielle du droit à l’immunité a conduit au pluralisme religieux, qui est la forme aujourd’hui universelle de l’indifférentisme social, et conduit toujours plus à l’indifférentisme des individus.
6 – Les limites du droit à la liberté religieuse
26 – Le père Basile nous objecte que les fameuses « normes morales objectives », dont parle DH et qui devraient conduire à limiter le droit à la liberté religieuse, « peuvent être tout aussi bien surnaturelles que naturelles » [35]. Il serait déjà pour le moins inquiétant qu’un texte conciliaire restât ainsi délibérément dans le vague, sur une question de telle importance. Mais laissant ce point, nous nous contenterons de poser à notre objectant la question à laquelle, du moins jusqu’ici, les représentants attitrés du Saint-Siège n’ont jamais apporté de réponse convaincante : comment concevoir un ordre moral surnaturel où l’on accorderait par principe aux hommes le droit de ne pas être empêchés de professer publiquement la religion qu’ils regardent comme vraie, que celle-ci soit en réalité vraie ou fausse ? Les religions fausses sont contraires au tout premier commandement de Dieu ; elles sont aussi contraires aux commandements du Christ, qui a prescrit de baptiser au nom des trois Personnes de la Sainte Trinité, qui exige de croire tout ce que ses apôtres et leurs successeurs enseigneront jusqu’à la fin des siècles, dans la dépendance de son unique vicaire, l’évêque de Rome, et qui impose sous peine de damnation éternelle l’appartenance à l’unique Eglise catholique romaine. Comment pourrait-il y avoir un ordre moral objectif, sans tenir compte de ce droit divinement révélé et donc sans empêcher la profession publique des religions fausses qui s’y opposent ? De deux choses l’une : soit DH reconnaît le droit à l’immunité aux adeptes de toutes les religions et alors les limites dont elle parle ne sont pas celles de l’ordre moral objectif (qui ne saurait être que surnaturel) ; soit ces limites sont bien celles de cet ordre moral surnaturel et alors DH ne saurait reconnaître le droit à l’immunité que pour les seuls membres de l’Eglise catholique. Il suffit de relire attentivement le texte de Dignitatis humanae, pour comprendre en quel sens doit se résoudre cette alternative. Non, les limites dont parle DH 7 ne sauraient être celles du véritable ordre moral surnaturel. DH 2 oblige à dire que ce sont celles d’un pseudo-ordre naturaliste. A moins de dire que DH est un texte intrinsèquement contradictoire ; mais alors, cela nous donne un motif déjà suffisant pour ne pas l’accepter.
7 – Nos conclusions
27 – Nous maintenons ici, avec d’autant plus de raisons, ce que nous écrivions dans le numéro de mars dernier du Courrier de Rome : « Dignitatis humanae est contraire à la Tradition ». Que le père Basile ne s’en soit pas encore aperçu n’est pas un motif suffisant pour le nier : magis amica veritas. Les rares textes du magistère antérieur à Vatican II que l’on voudrait alléguer en faveur de la liberté religieuse, s’ils sont bien compris, ne fournissent absolument pas l’argument escompté et vont même dans le sens contraire à cette nouvelle doctrine. Quanta cura représente même la contradictoire de Dignitatis humanae.
28 – Quant aux explications du père Basile, elles demeurent vaines, principalement pour trois raisons.
29 – Premièrement, elles ne font pas la distinction entre le sujet et l’objet du droit. Dire que c’est la personne humaine et non pas l’erreur qui jouit du droit à l’immunité n’est pas une réponse, puisque cela revient à dire que c’est le sujet du droit qui jouit du droit, non l’objet du droit. En effet, la question posée, et à laquelle cette distinction ne répond pas, concerne précisément l’objet du droit. Le droit à l’immunité, tel que départi par DH à tout homme, a pour objet l’exercice public de toute religion, vraie ou fausse, pourvu seulement que l’homme la tienne (à tort ou à raison) pour vraie. Ce droit négatif a donc pour objet tout uniment la religion vraie et les religions fausses : c’est un droit négatif à l’erreur aussi bien qu’à la vérité.
30- Deuxièmement, l’adage selon lequel « l’abus du droit n’enlève pas l’usage du droit » est employé par le père Basile au prix d’une pétition de principe. Car pour pouvoir appliquer cet adage dans le cas de la liberté religieuse, il faudrait d’abord commencer par prouver que l’abus en question est bien celui d’un droit. Or, c’est le contraire qui est vrai. Sans doute, oui, ce n’est pas n’importe quel péché qui suffit à faire perdre par exemple l’usage du droit à la vie [36]. Ce sont seulement les péchés directement opposés à la vie qui font perdre ce droit. Mais il reste que le droit à la vie est dûment établi comme tel. A l’inverse, l’immunité en matière de profession religieuse, telle que la définit DH, ne peut pas se définir comme un droit. Car précisément, l’exercice d’une religion fausse constitue non pas l’exercice abusif d’un droit, mais un péché directement opposé à la religion, et la négation même du droit, qui ne saurait avoir pour objet que l’exercice de la vraie religion.
31 – Enfin troisièmement, et plus profondément, les explications du père Basile présupposent que l’objet du droit est non pas ce qui est vrai et bien, mais ce que la conscience présente comme vrai et bien. Ce présupposé subjectiviste et relativiste correspond à une prise de position philosophique. Jamais ni le magistère de l’Eglise ni la sainte théologie ne l’ont admis, du moins jusqu’à Vatican II. Même encore dans l’Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII parle précisément (c’est ce que l’on peut lire dans le texte original en latin) d’un droit de l’homme à exercer « la religion » et non pas « sa religion ». Il est dit en effet : « In hominis juribus hoc quoque numerandum est ut et Deum ad rectam conscientiae suae normam venerari possit, et religionem privatim publiceque profiteri ». Dans la note 26 de son étude de juillet 2013 [37], le père Basile corrige ce texte et parle du droit de professer « sa religion », alors que le pape parle exactement du droit de professer « la religion », et ce conformément à ce que représente « la règle droite de la conscience », c’est à dire la règle d’une conscience non erronée. La correction fautive introduite par le père Basile est symptomatique de cette déformation d’esprit, qui conduit à envisager les choses d’un point de vue avant tout subjectif.
32 – Cette déformation d’esprit est le propre de la pensée moderne. Faut-il s’étonner de la voir sévir à ce point aujourd’hui dans l’Eglise, même chez les meilleurs esprits, dès lors que l’intention du dernier concile œcuménique fut justement d’exprimer la foi de l’Eglise suivant les modes de recherche et de formulation littéraire de la pensée moderne [38], et de redéfinir la relation de la foi de l’Eglise vis-à-vis de certains éléments essentiels de cette pensée [39]?
Abbé Jean-Michel Gleize (N.B.)
- BV1, P. 289.[↩]
- BV1, p. 299.[↩]
- Sur les quelques 3000 pages de la thèse parue en 1995 (1e édition) et 1998 (2e édition), où le père Basile tente de présenter le droit à la liberté religieuse comme le développement doctrinal homogène de la Tradition de l’Eglise, on pourra se reporter à l’étude de notre confrère, monsieur l’abbé Guy Castelain, « Un roman sur la liberté religieuse » dans Fideliter n° 133 de janvier-février 2000, p. 5–11.[↩]
- CDR, § 8.[↩]
- Mgr Lefebvre, J’accuse le Concile, 1976, p. 9[↩]
- BV2, I).[↩]
- CDR, § 11.[↩]
- BV2, I), A), b).[↩]
- Benoît XVI, « Discours à l’union des juristes catholiques italiens le 9 décembre 2006 », DC n° 2375, p. 214–215.[↩]
- Saint Pie X, Vehementer nos du 11 février 1906 dans Actes de saint Pie X, la Bonne Presse, t. II, p. 127.[↩]
- Saint Pie X, Notre charge apostolique du 25 août 1910 dans Enseignements pontificaux de Solesmes, La Paix intérieure des nations, n° 430.[↩]
- Léon XIII, Encyclique Libertas du 20 juin 1888 dans Enseignements pontificaux de Solesmes, La Paix intérieure des nations, n° 215.[↩]
- BV2, I), B).[↩]
- BV2, I), D).[↩]
- BV2, ibidem.[↩]
- CDR, § 24.[↩]
- CDR, § 12–15.[↩]
- CDR, § 11 : Jean-Paul II, « Message du 8 décembre 1987 pour la Journée mondiale 1988 de la paix », DC 1953, p. 2–4.[↩]
- Le père Basile donne une référence inexacte à notre étude : nous citons Benoît XVI au § 14, et non comme il le prétend au § 15.[↩]
- Benoît XVI, « Message du 8 décembre 2010 pour la Journée mondiale 2011 de la paix », DC n° 2459, p. 4–5.[↩]
- BV2, II), A), 1), 1), 4°), citant Dom Joseph Baucher (1866–1929), « Liberté » dans DTC, t. IX (1926), col. 701.[↩]
- BV2, II), A), 1), 1), 5°).[↩]
- Cajetan, Commentaire sur la Somme théologique de saint Thomas, 2a2ae pars, question 10, article 12, n° VI, cité dans CDR, § 24.[↩]
- BV2, II), A), 1), 2).[↩]
- CDR, § 10.[↩]
- CDR, § 12.[↩]
- BV2, II), B), 1), 1).[↩]
- Cf. saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1a2ae, question 19, articles 5 et 6, ainsi que le numéro de décembre 2013 du Courrier de Rome.[↩]
- BV2, ibidem.[↩]
- BV2, II), B), 1), 2).[↩]
- BV2, III), A).[↩]
- Somme théologique, 2a2ae, question 10, article 12, ad 5.[↩]
- BV2, IV), A).[↩]
- CDR, § 4–6 et 20–22.[↩]
- BV2, V), B).[↩]
- BV2, 6e conclusion.[↩]
- BV1, p. 294.[↩]
- Jean XXIII dans DC n° 1387, col. 1382–1383 et DC n° 1391, col. 101.[↩]
- Benoît XVI, dans DC n° 2350, col. 59–63.[↩]