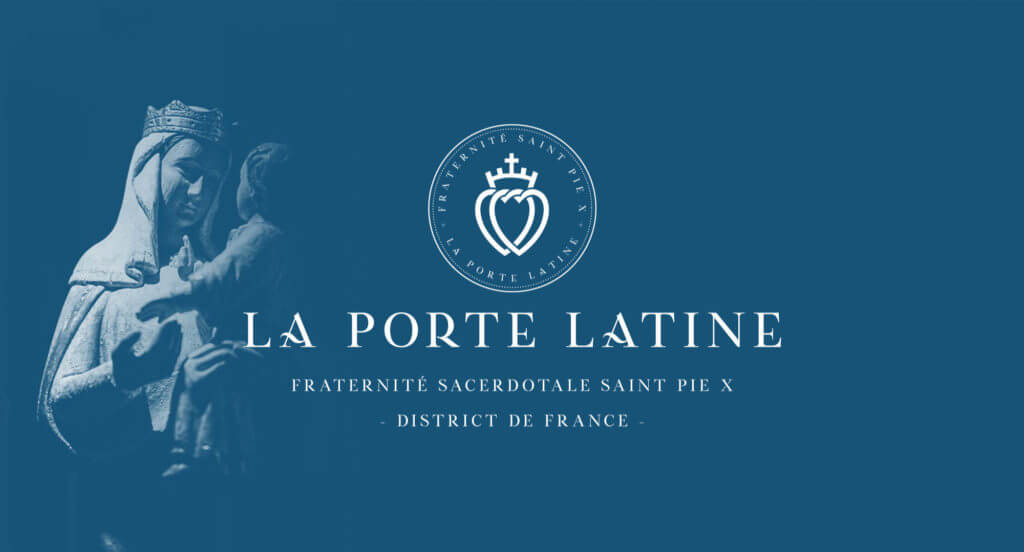En 2004, à l’occasion des vingt-cinq ans de pontificat du pape Jean-Paul II, la Fraternité Saint Pie X envoyait officiellement à Rome l’étude suivante dont le titre est une allusion aux paroles de Jean-Paul II lui-même, qui dénonçait en 2003, une « apostasie silencieuse ». Cette apostasie n’a-t-elle pas son germe dans les innovations du Concile Vatican II ? C’est la thèse ici soutenue et solidement argumentée, qui n’a, à ce jour, reçu aucune réponse de la part des autorités romaines.
Lettre aux cardinaux
Éminence Révérendissime,
A l’occasion des vingt-cinq ans du pontificat du pape Jean-Paul II, il nous a paru important de nous adresser à vous, ainsi qu’aux autres cardinaux, afin de vous faire partager nos préoccupations majeures sur la situation de l’Église. En raison de l’aggravation de l’état de santé du Saint Père, nous avons renoncé à lui écrire directement bien que, initialement, l’étude ci-jointe lui ait été personnellement destinée.
Par-delà l’optimisme qui entourait les célébrations de ce 25ème anniversaire, la situation extrêmement grave que traverse tant le monde que l’Église catholique n’échappe à personne. Le Pape lui-même, en son Exhortation apostolique Ecclesia in Europa, reconnaît notamment que le temps que nous vivons est celui d’une « apostasie silencieuse » où règne une sorte « d’agnosticisme pratique et d’indifférentisme religieux, qui fait que beaucoup d’Européens donnent l’impression de vivre sans terreau spirituel et comme des héritiers qui ont dilapidé le patrimoine qui leur a été légué [1]. »
Parmi les principales causes de ce bilan tragique, comment ne pas ranger au premier plan l’œcuménisme, initié officiellement par Vatican II et promu par Jean-Paul II ? Dans le but avoué de réaliser une unité nouvelle, au nom d’une volonté de « regarder davantage ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise », on prétend sublimer, réinterpréter ou mettre de côté les éléments spécifiquement catholiques qui apparaissent comme causes de division. Ainsi, méprisant l’enseignement constant et unanime de la Tradition selon lequel le Corps mystique du Christ est l’Église catholique et qu’en dehors d’elle il n’y a pas de salut, cet œcuménisme a comme détruit les plus beaux trésors de l’Église parce que, au lieu d’accepter l’Unité fondée sur la vérité entière, il a voulu construire une unité adaptée à une vérité mariée d’erreur.
Cet œcuménisme a été la principale cause d’une réforme liturgique dont on sait l’effet désastreux sur la foi et la pratique religieuse des fidèles. C’est lui qui a corrigé la Bible, dénaturant le texte divinement inspiré pour en présenter une version édulcorée, inapte à fonder la foi catholique. C’est lui qui maintenant vise à fonder une nouvelle Église dont le cardinal Kasper, dans une récente conférence [2], précisait les contours. Jamais nous ne pourrons être en communion avec les promoteurs d’un tel œcuménisme qui tend à dissoudre l’Église catholique, c’est-à-dire le Christ en son Corps mystique et qui détruit l’unité de la foi, vrai fondement de cette communion. De leur unité, nous ne voulons pas, parce qu’elle n’est pas celle voulue de Dieu, elle n’est pas celle qui caractérise l’Église catholique.
C’est donc cet œcuménisme que nous entendons analyser et dénoncer par le document ci-joint, car nous sommes persuadés que l’Église ne pourra correspondre à sa divine mission si elle ne commence par renoncer clairement à cette utopie et à la condamner fermement, utopie qui, selon les propres termes de Pie XI, « disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique [3]. »
Conscients d’appartenir de plein droit à cette même Église et désireux de toujours plus la servir, nous vous supplions de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que le Magistère actuel retrouve bien vite le langage multiséculaire de l’Église selon lequel « l’union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu’en favorisant le retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, qu’ils ont eu jadis le malheur de quitter [4]. » C’est alors que l’Église catholique redeviendra tout à la fois phare de vérité et port de salut au sein d’un monde qui court à sa ruine parce que le sel s’y est affadi.
Veuillez croire, Eminence, que nous ne voulons aucunement nous substituer au Saint Père, mais nous attendons cependant du Vicaire du Christ les mesures énergiques et nécessaires pour sortir l’Eglise de l’embourbement dans lequel l’a mis un œcuménisme faux. Celui qui a reçu le pouvoir suprême, plénier et universel sur toute l’Eglise peut poser ces actes salutaires. Du Successeur du Pierre, nous espérons, dans la prière, qu’il écoute notre appel alarmé et qu’il manifeste jusqu’à l’héroïsme cette charité qui a été demandée au premier pape à la réception de sa charge, la plus grande des charités – « Amas Me plus his » (Jn 21, 16–17) – celle qui doit sauver l’Eglise.
Daigne votre Éminence croire en nos sentiments respectueux et dévoués en Jésus et Marie.
Menzingen, le 6 janvier 2004, en la fête de l’Epiphanie
+ Bernard Fellay Supérieur général
Franz Schmidberger +, Premier Assistant général
+ Alfonso de Galarreta Second Assistant général
+ Bernard Tissier de Mallerais
+ Richard Williamson
Introduction
1. Le 25e anniversaire de l’élection de Jean-Paul II est l’occasion de réfléchir sur l’orientation fondamentale que le Pape a donnée à son pontificat. Dans la suite du concile Vatican II, il a voulu le placer sous le signe de l’unité : « La restauration de l’unité de tous les chrétiens était l’un des buts principaux du IIe concile du Vatican (cf. UR nº 1) et, dès mon élection, je me suis engagé formellement à promouvoir l’exécution de ses normes et de ses orientations, considérant que c’était là pour moi un devoir primordial [5] » Cette “restauration de l’unité des chrétiens” marquait, selon Jean-Paul II, un pas vers une unité plus grande, celle de la famille humaine tout entière : « L’unité des chrétiens est ouverte sur une unité toujours plus vaste, celle de l’humanité tout entière. [6] »
2. En raison de ce choix fondamental, Jean-Paul II a estimé devoir « reprendre en main cette “magna charta” conciliaire qu’est la constitution dogmatique Lumen gentium [7] » laquelle définit l’Église comme un « sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. [8] » Cette “reprise en main” était faite en vue de « réaliser toujours mieux cette communion vitale dans le Christ de tous ceux qui croient et espèrent en lui, mais également en vue de contribuer à une plus ample et plus forte unité de la famille humaine tout entière [9] » ; Jean-Paul II a consacré l’essentiel de son pontificat à la poursuite de cette unité, multipliant rencontres interreligieuses, repentances et gestes œcuméniques. Ce fut également la principale raison de ses voyages : « Ils ont permis d’atteindre les Églises particulières dans tous les continents, en portant une attention soutenue au développement des relations œcuméniques avec les chrétiens des différentes Confessions [10] » ; Jean-Paul II a donné l’œcuménisme pour trait caractéristique du Jubilé de l’an 2000. [11] En toute vérité, donc, « on peut dire que toute l’activité des Églises locales et du Siège apostolique ont eu ces dernières années un souffle œcuménique. [12] » Désormais, vingt-cinq ans ont passé, le Jubilé s’en est allé : l’heure des bilans a sonné.
3. Longtemps, Jean-Paul II a cru que son pontificat serait un nouvel Avent [13] permettant à « l’aube de ce nouveau millénaire [de] se lever sur une Église qui a retrouvé sa pleine unité. [14] » Alors se serait réalisé le « rêve » du Pape : « Tous les peuples du monde en marche, de différents lieux de la Terre, pour se réunir auprès du Dieu unique comme une seule famille. [15] » La réalité est tout autre : « Le temps que nous vivons apparaît comme une époque d’égarement [où] beaucoup d’hommes et de femmes semblent désorientés. [16] » Règne par exemple sur l’Europe une « sorte d’agnosticisme pratique et d’indifférentisme religieux », au point que « la culture européenne donne l’impression d’une “apostasie silencieuse.” [17] » L’œcuménisme n’est pas étranger à cette situation. L’analyse de la pensée de Jean-Paul II (1re partie) nous fera constater, non sans une profonde tristesse, que la pratique œcuménique est héritée d’une pensée étrangère à la doctrine catholique (2e partie) et mène à l’“apostasie silencieuse” (3e partie).
Chapitre I. Analyse de la pensée œcuménique
L’unité du genre humain et le dialogue interreligieux
Le Christ, uni à chaque homme
4. A la base de la conception du Pape se trouve l’affirmation selon laquelle « Jésus-Christ (qui) “s’est uni d’une certaine manière à tous les hommes” (Gaudium et spes, nº 22), même si ceux-ci n’en sont pas conscients. [18] » Jean-Paul II explique en effet que la Rédemption apportée par le Christ est universelle non seulement en ce sens qu’elle est surabondante pour le genre humain tout entier et qu’elle est proposée à chacun de ses membres en particulier, mais surtout parce qu’elle est appliquée de fait à tous les hommes : si donc, d’un côté, « dans le Christ, la religion n’est plus une “recherche de Dieu comme à tâtons” (Act 17, 27), mais une réponse de la foi à Dieu qui se révèle […], réponse rendue possible par cet Homme unique […] en qui tout homme est rendu capable de répondre à Dieu », de l’autre, le Pape ajoute « [qu’] en cet Homme, la création entière répond à Dieu. [19] » En effet, « chacun a été inclus dans le mystère de la Rédemption, et Jésus-Christ s’est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère. […] C’est cela, l’homme dans toute la plénitude du mystère dont il est devenu participant en Jésus-Christ et dont devient participant chacun des quatre milliards d’hommes vivant sur notre planète, dès l’instant de sa conception. [20] » De la sorte, « dans l’Esprit-Saint, chaque personne et chaque peuple sont devenus, par la croix et la résurrection du Christ, des enfants de Dieu, des participants de la nature divine et des héritiers de la vie éternelle. [21] »
Le congrès d’Assise
5. Cet universalisme de la Rédemption trouve son application immédiate dans la manière dont Jean-Paul II pratique les relations entre l’Église catholique et les autres religions. En effet, si l’ordre de l’unité précédemment décrit « est celui qui remonte à la création et à la rédemption et s’il est donc, en ce sens, “divin”, ces différences et ces divergences [citées plus haut], même religieuses, remontent plutôt à un “fait humain” [22] » et doivent donc « être dépassées dans le progrès vers la réalisation du grandiose dessein d’unité qui préside à la création. [23] » D’où les réunions interreligieuses telles que celle d’Assise, le 27 octobre 1986, en laquelle le Pape a voulu déceler « de manière visible, l’unité cachée mais radicale que le Verbe divin […] a établie entre les hommes et les femmes de ce monde. [24] » Par de tels gestes, le Pape entend faire proclamer à l’Église que « le Christ est la réalisation de l’aspiration de toutes les religions du monde et, par cela même, il en est l’aboutissement unique et définitif. [25] »
L’Église du Christ et l’Œcuménisme
L’unique Église du Christ
6. Un double ordre : unité divine demeurant inviolée, et divisions historiques qui ne relèvent que de l’humain ; telle est encore la grille appliquée à l’Église, considérée comme communion. Jean-Paul II distingue en effet l’Église du Christ, réalité divine, des différentes Églises, fruits des “divisions humaines” [26]. L’Église du Christ, aux contours assez mal définis du fait qu’elle déborde des limites visibles de l’Église catholique [27], est une réalité intérieure [28]. Elle rassemble pour le moins l’ensemble des chrétiens [29]), quelle que soit leur appartenance ecclésiale : tous sont « disciples du Christ [30] », « dans une appartenance commune au Christ [31] » ; ils « sont un parce que, dans l’Esprit, ils sont dans la communion du Fils et, en lui, dans sa communion avec le Père. [32] » L’Église du Christ est donc communion des saints, par delà les divisions : « L’Église est Communion des saints. [33] » En effet, « la communion en laquelle les chrétiens croient et espèrent est, en sa réalité la plus profonde, leur unité avec le Père par le Christ et dans le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, elle est donnée et reçue dans l’Église, communion des saints. [34] »
Les divisions ecclésiales
7. D’après Jean-Paul II, les divisions ecclésiales survenues au cours de l’histoire n’auraient pas affecté l’Église du Christ, autrement dit auraient laissé inviolée l’unité radicale des chrétiens entre eux : « Par la grâce de Dieu, ce qui appartient à la structure de l’Église du Christ n’a pourtant pas été détruit, ni la communion qui demeure avec les autres Églises et Communautés ecclésiales. [35] » Ces divisions sont en effet d’un autre ordre ; elles ne concernent que la manifestation de la communion des saints, ce qui la rend visible : les traditionnels liens de la profession de foi, des sacrements et de la communion hiérarchique. En refusant l’un ou l’autre de ces liens, les Églises séparées ne portent atteinte qu’à la communion visible avec l’Église catholique, et encore seulement de manière partielle : cette dernière communion est capable de plus ou de moins, selon qu’un plus ou moins grand nombre de liens auront été sauvegardés. On parlera alors de communion imparfaite entre les Églises séparées et l’Église catholique, la communion de tous dans l’unique Église du Christ demeurant sauve [36]. Le terme d’ “Eglises-sœurs” sera souvent utilisé [37].
8. Selon cette conception, ce qui unit entre elles les différentes Églises chrétiennes est plus grand que ce qui les sépare [38] : « L’espace spirituel commun l’emporte sur bien des barrières confessionnelles qui nous séparent encore les uns des autres. [39] » Cet espace spirituel, voilà l’Église du Christ. Si celle-ci ne « subsiste [40] » « en un unique sujet [41] » que dans l’Église catholique, elle n’en garde pas moins une « présence active » dans les Communautés séparées en raison des « éléments de sanctification et de vérité [42] » qui y sont présents. C’est ce prétendu espace spirituel commun que Jean-Paul II a voulu sceller par la publication d’un martyrologe commun aux Églises : « L’œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui qui convainc le plus. La voix de la communio sanctorum est plus forte que celle des fauteurs de division. [43] »
Ni absorption ni fusion, mais don réciproque
9. Dès lors, « le but ultime du mouvement œcuménique » n’est que « le rétablissement de la pleine unité visible de tous les baptisés. [44] » Une telle unité ne se réalisera plus par l’“œcuménisme de retour” [45] : « Nous le rejetons comme méthode de recherche d’unité. […] L’action pastorale de l’Église catholique tant latine qu’orientale ne tend plus à faire passer les fidèles d’une Église à l’autre. [46] » Ce serait en effet oublier deux choses : Ces divisions, que le concile Vatican II analyse comme des manquements à la charité [47], sont imputables de part et d’autre : « Evoquant la division des chrétiens, le décret sur l’œcuménisme n’ignore pas “la faute des hommes de l’une et l’autre partie”, en reconnaissant que la responsabilité ne peut être attribuée uniquement “qu’aux autres (UR, 3).” [48] » L’œcuménisme est aussi « échange de dons [49] » entre les Églises : « L’échange des dons entre les Églises, dans leur complémentarité rend féconde la communion. [50] » C’est pourquoi l’unité souhaitée par Jean-Paul II « n’est pas absorption ni même fusion. [51] » Appliquant ce principe aux relations entre l’Église catholique et les orthodoxes, le Pape développe : « Les deux Eglises-sœurs d’Orient et d’Occident comprennent aujourd’hui que sans une écoute réciproque des raisons profondes qui sous-tendent en chacune d’elles la compréhension de ce qui les caractérise, sans un don réciproque des trésors du génie dont chacune est porteuse, l’Église du Christ ne peut manifester la pleine maturité de cette forme qu’elle a reçue au début, dans le Cénacle. [52] »
La recomposition de l’unité visible
10. « De même que dans la famille les éventuelles dissensions doivent être dépassées par la recomposition de l’unité, c’est ainsi que l’on doit faire dans la famille plus vaste de la communauté chrétienne tout entière. [53] » Dépasser les dissensions humaines par la recomposition de l’unité visible, telle est la méthodologie du Pape. Il faudra l’appliquer dans les trois liens traditionnels de la profession de foi, des sacrements et de la communion hiérarchique, du fait que ce sont eux qui constituent la visibilité de l’unité.
L’unité de sacrements
11. On sait comment Paul VI s’y est employé en matière de sacrements : dans les réformes liturgiques successives qui ont appliqué les décrets conciliaires, « l’Église a été guidée (…) par le désir de tout faire pour faciliter à nos frères séparés le chemin de l’union, en écartant toute pierre qui pourrait constituer ne serait-ce que l’ombre d’un risque d’achoppement ou de déplaisir. [54] »
12. L’obstacle d’une liturgie catholique trop expressive du dogme ainsi écarté, il restait à dépasser la difficulté posée par les liturgies des communautés séparées. La réforme fit alors place à la reconnaissance : bien qu’elle ne contienne pas les paroles consécratoires, l’anaphore assyrienne (nestorienne) d’Addaï et Mari fut décrétée valide en un document expressément approuvé par Jean-Paul II [55].
L’unité dans la profession de foi
13. En matière de foi, Jean-Paul II estime que, bien souvent, « les polémiques et les controverses intolérantes ont transformé en affirmations incompatibles ce qui était en fait le résultat de deux regards scrutant la même réalité, mais de deux points de vue différents. Il faut trouver aujourd’hui la formule qui, saisissant cette réalité intégralement, permette de dépasser les lectures partielles et d’éliminer les interprétations erronées. [56] » Cela réclame une certaine latitude par rapport aux formules dogmatiques jusque là employées par l’Église. On recourra donc au relativisme historique, afin de faire dépendre les formules dogmatiques de leur époque : « Les vérités que l’Église entend réellement enseigner par ses formules dogmatiques sont sans doute distinctes des conceptions changeantes propres à une époque déterminée ; mais il n’est pas exclu qu’elles soient éventuellement formulées, même par le Magistère, en des termes qui portent des traces de telles conceptions. [57] »
14. Deux applications de ces principes sont souvent citées. Dans le cas de l’hérésie nestorienne, Jean-Paul II estime que « les divisions qui se sont produites étaient dues dans une large mesure à des malentendus. [58] » En effet, si le principe qui affirme que « en premier lieu, devant des formulations doctrinales qui se séparent des formules en usage dans la communauté à laquelle on appartient, il convient manifestement de discerner si les paroles ne recouvrent pas un contenu identique [59] » est clair, l’application qui en est faite est détournée. C’est ainsi que la reconnaissance de foi christologique de l’Église assyrienne d’Orient, sans que lui ait été réclamée l’adhésion à la formule d’Ephèse selon laquelle Marie est Mère de Dieu, fait fi des condamnations antérieures, sans tenir compte de leur aspect infaillible [60]. Plus caractéristique encore est la déclaration commune avec la Fédération luthérienne mondiale. Son souci ne fut pas de dire la foi et d’écarter l’erreur, mais seulement de trouver une formulation apte à échapper aux anathèmes du concile de Trente : « Cette déclaration commune est portée par la conviction que le dépassement des condamnations et des questions jusqu’alors controversées ne signifie pas que les séparations et les condamnations soient prises à la légère ou que le passé de chacune de nos traditions ecclésiales soit désavoué. Elle est cependant portée par la conviction que de nouvelles appréciations adviennent dans l’histoire de nos Églises. [61] » D’un mot bien simple, le cardinal Kasper commentera cette déclaration : « Là où nous avions vu au premier abord une contradiction, nous pouvons voir une position complémentaire. [62] »
La communion hiérarchique
15. Quant au ministère pétrinien, les souhaits pontificaux sont connus : trouver, de concert avec les pasteurs et théologiens des différentes Églises, « les formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d’amour reconnu par les uns et par les autres. [63] » On introduira alors le régulateur de la necessitas Ecclesiæ [64], comprise aujourd’hui comme réalisation de l’unité des chrétiens, pour atténuer ce qui, dans l’exercice du ministère pétrinien, pourrait être obstacle à l’œcuménisme.
16. Selon le cardinal Kasper, cette démarche ne suffit pas. Il faut encore dépasser les obstacles présents dans les communautés séparées, par exemple l’invalidité décrétée des ordinations anglicanes [65]. La piste qu’il propose pour cela est une redéfinition du concept de succession apostolique, non plus « dans le sens d’une chaîne historique d’imposition des mains remontant à travers les siècles à un apôtre – ce serait une vision très mécanique et individualiste » mais comme « participation collégiale dans un collège qui, comme un tout, remonte aux apôtres par le partage de la même foi apostolique et par la même mission apostolique. [66]
Chapitre II. Les problèmes doctrinaux posés par l’œcuménisme [67]
17. La pratique œcuménique de ce pontificat repose tout entière sur la distinction Église du Christ /Église catholique, laquelle permet d’avancer que, si la communion visible a été blessée par les divisions ecclésiales, la communion des saints, considérée comme partage des biens spirituels dans la commune union au Christ, n’a pas été brisée. Or, cette affirmation ne tient pas devant la foi catholique.
L’Église du Christ est l’Église catholique
18. On ne peut distinguer l’Église du Christ de l’Église catholique ainsi que le suppose la pratique œcuménique. Par le fait même qu’elle est considérée comme réalité intérieure, cette “Église Corps du Christ”, distincte réellement de l’Église catholique, rejoint la notion protestante d’une « Église invisible pour nous, visible aux seuls yeux de Dieu. [68] » Elle est contraire aux enseignements constants de l’Église. Léon XIII, parlant de l’Église, affirme par exemple : « C’est parce que [l’Église] est corps qu’elle est visible à nos regards. [69] » Pie XI ne dit pas autre chose : « Son Église, le Christ Notre Seigneur l’a établie en société parfaite, extérieure par nature et perceptible aux sens. [70] » Pie XII conclura donc : « C’est s’éloigner de la vérité divine que d’imaginer une Église qu’on ne pourrait ni voir ni toucher, qui ne serait que “spirituelle” (pneumaticum), dans laquelle les nombreuses communautés chrétiennes, bien que divisées entre elles par la foi, seraient pourtant réunies par un lien invisible. [71] »
19. La foi catholique oblige donc à affirmer l’identité de l’Église du Christ et de l’Église catholique. C’est ce que fait Pie XII en identifiant « le Corps mystique de Jésus-Christ » à « cette véritable Église de Jésus-Christ – celle qui est sainte, catholique, apostolique, romaine. [72] » Avant lui, le Magistère avait affirmé qu’ » il n’y pas d’autre Église que celle qui, bâtie sur Pierre seul, en un corps joint et assemblé [entendez “visible”], se dresse dans l’unité de la foi et de la charité. [73] » Rappelons enfin l’exclamation de Pie IX : « Il n’y a en effet qu’une seule religion vraie et sainte, fondée et instituée par le Christ Notre-Seigneur. Mère et nourrice des vertus, destructrice des vices, libératrice des âmes, indicatrice du vrai bonheur ; elle s’appelle : Catholique, Apostolique et Romaine. [74] » Suite à un magistère constant et universel, le 1er schéma préparatoire de Vatican I était en droit d’avancer ce canon condamnatoire : « Si quelqu’un dit que l’Église, à qui ont été faites les promesses divines n’ est pas une société (cœtus) externe et visible de fidèles, mais une société spirituelle de prédestinés ou de justes connus de Dieu seul, qu’il soit anathème. [75] »
20. Par voie de conséquence, la proposition du cardinal Kasper selon laquelle : « La véritable nature de l’Église – l’Église en tant que corps du Christ – est cachée et n’est saisissable que par la foi [76] » est certainement hérétique. Ajouter que « cette nature saisissable uniquement par la foi s’actualise sous des formes visibles : dans la Parole proclamée, l’administration des sacrements, les ministères et le service chrétien [77] » est insuffisant pour rendre compte de la visibilité de l’Église : “se rendre visible” – qui plus est par de simples actes – n’est pas “être visible”.
L’appartenance à l’Église par la triple unité
21. Du fait que l’Église du Christ est l’Église catholique, on ne peut affirmer avec les partisans de l’œcuménisme que « la triple unité de foi, de sacrement et de communion hiérarchique n’est nécessaire qu’à la seule communion visible de l’Église », dans ce sens que l’absence d’un de ces liens, si elle manifeste la rupture de la communion visible de l’Église, ne signifie pas la séparation vitale d’avec l’Église. Il faut au contraire affirmer que ces trois liens sont constitutifs de l’unité de l’Église, non en ce sens qu’un seul unirait à l’Église, mais du fait que si un seul de ces trois liens n’était pas possédé in re vel saltem in voto [78], celui à qui il ferait défaut serait séparé de l’Église et ne bénéficierait pas de la vie surnaturelle. C’est ce que la foi catholique oblige à croire, ainsi que le montre ce qui suit.
Unité de foi
22. Si la nécessité de la foi est admise par tous [79], il faut encore préciser la nature de cette foi qui est nécessaire au salut, et donc constitutive de l’appartenance à l’Église. Elle n’est pas « ce sentiment intime engendré par le besoin divin » dénoncé par saint Pie X [80], mais bien cette foi décrite par le concile Vatican I : « une vertu surnaturelle par laquelle, sous l’inspiration et avec le secours de la grâce de Dieu, nous croyons que ce qui nous a été révélé par lui est véritable : nous le croyons, non point à cause de la vérité intrinsèque des choses vues dans la lumière naturelle de notre raison, mais à cause de l’autorité même de Dieu qui nous révèle ces vérités, et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. [81] » C’est pourquoi celui qui refuse ne serait-ce qu’une vérité de foi connue comme révélée perd totalement la foi indispensable au salut : « Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu’il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu’il est la souveraine vérité et le motif propre de foi. [82] »
Unité de gouvernement
23. « Afin de maintenir toujours en son Église cette unité de foi et de doctrine, il [le Christ] choisit un homme parmi tous les autres, Pierre… [83] » : c’est ainsi que Pie IX introduit la nécessité de l’unité à la chaire de Pierre, « dogme de notre divine religion [qui] a toujours été prêché, défendu, affirmé d’un cœur et d’une voix unanimes par les Pères et les Conciles de tous les temps. » A la suite des Pères, le même Pape développe : « C’est d’elle [la chaire de Pierre] que découlent sur tous les droits à l’union divine [84] ; […] celui qui la quitte ne peut espérer rester dans l’Église [85], celui qui mange l’Agneau en dehors d’elle n’a pas de part avec Dieu [86] » D’où la célèbre parole que saint Augustin adresse aux schismatiques : « Ce qui est vôtre, c’est que vous avez eu l’impiété de vous séparer de nous ; car, si pour tout le reste, vous pensiez et possédiez la vérité, en persévérant néanmoins dans votre séparation […] il ne vous manque que ce qui manque à celui à qui la charité fait défaut. [87] »
Unité de sacrements
24. « Celui croira et sera baptisé sera sauvé. [88] » A travers cette parole de Notre-Seigneur, tous reconnaissent la nécessité, outre de l’unité de foi et de but, d’une « communauté […] de moyens appropriés au but [89] » pour constituer l’unité de l’Église : les sacrements. Telle est donc « l’Église catholique [que le Christ institua], acquise par son sang, comme l’unique demeure du Dieu vivant […] le corps unique animé et vivifié par un Esprit unique, maintenu dans la cohésion et la concorde par l’unité de foi, d’espérance et de charité, par les liens des sacrements, du culte et de la doctrine. [90] »
Conclusion
25. La nécessité de ce triple lien oblige donc à croire que « celui qui refuse d’écouter l’Église doit être considéré, selon l’ordre du Seigneur, “comme un païen et un publicain” (Mt 18, 17) et ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même Corps ni par conséquent de ce même Esprit divin. [91] »
Hors de l’Église, point de salut
Les non-catholiques sont-ils membres de l’Église ?
26. En conséquence de ce qui vient d’être dit, la proposition suivante : « Ceux [nés hors de l’Église catholique et donc ne pouvant “être accusés de péché de division”] qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, avec l’Église catholique » au point que « justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l’Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur » alors que « des divergences variées entre eux et l’Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l’Église, constituent nombre d’obstacles, parfois fort graves [92] » doit être soigneusement pesée ; si cette proposition entend parler de ceux qui demeurent dans ces divergences pourtant connues d’eux-mêmes, elle est contraire à la foi catholique. L’incise affirmant que « ils ne peuvent être accusés de péché de division » est pour le moins téméraire : restant extérieurement dans la dissidence, rien n’indique qu’ils n’adhèrent pas à la division de leurs prédécesseurs, l’apparence portant plutôt à croire le contraire. Présumer la bonne foi n’est pas ici possible [93], ainsi que le rappelle Pie IX : « Il faut admettre de foi que, hors de l’Église apostolique romaine, personne ne peut être sauvé. […] Cependant, il faut aussi reconnaître d’autre part, avec certitude, que ceux qui sont à l’égard de la vraie religion dans une ignorance invincible n’en portent point la faute devant le Seigneur. Maintenant, à la vérité, qui ira dans sa présomption, jusqu’à marquer les frontières de cette ignorance [94] ? »
Y a-t-il des éléments de sanctification et de vérité dans les communautés séparées ?
27. L’affirmation selon laquelle « de nombreux éléments de sanctification et de vérité [95] » se trouvent hors de l’Église est équivoque. Elle suppose en effet l’efficacité sanctifiante des moyens de salut matériellement présents dans les Communautés séparées. Or ce présupposé ne peut être affirmé sans distinction. Parmi ces éléments, ceux qui ne réclament pas de disposition spécifique de la part du sujet – le baptême d’un enfant – sont effectivement salvifiques en ce sens qu’ils produisent efficacement la grâce dans l’âme du baptisé, qui alors appartient à l’Église catholique de plein droit tant qu’il n’a pas atteint l’âge des choix personnels [96]. Pour les autres éléments, qui réclament des dispositions de la part du sujet pour être efficaces, on doit dire qu’ils sont salvifiques seulement dans la mesure où le sujet est déjà membre de l’Église par son désir implicite. C’est ce qu’affirme la doctrine des conciles : « Elle [l’Église] professe que l’unité du corps de l’Église a un tel pouvoir que les sacrements de l’Église n’ont d’utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. [97] » Or en tant qu’elles sont séparées, ces communautés s’opposent à ce désir implicite qui seul rend les sacrements fructueux. On ne peut donc dire de ces communautés qu’elles possèdent des éléments de sanctification et de vérité, sinon matériellement.
L’Esprit-Saint se sert-il des communautés séparées comme moyens de salut ? Les “Églises-sœurs”
28. On ne peut affirmer que « l’Esprit du Christ ne refuse pas de se servir d’elles [des communautés séparées] comme de moyens de salut. [98] » Saint Augustin affirme en effet : « Il n’y a qu’une seule véritable Église, appelée Église catholique ; autour d’elle circulent un certain nombre de sectes séparées de son unité ; et s’il arrive que ces sectes engendrent, ce n’est pas elles qui engendrent, c’est l’Église catholique qui engendre en elles et par elles. [99] » La seule chose que ces communautés séparées peuvent réaliser par leur propre vertu, c’est la séparation de ces âmes de l’unité ecclésiale, comme l’indique encore saint Augustin : « Il n’est point vôtre [le baptême], ce qui est vôtre c’est que vous avez des sentiments mauvais et des pratiques sacrilèges, et que vous avez eu l’impiété de vous séparer de nous. [100] » Dans la mesure où elle remet en cause l’affirmation selon laquelle l’Église catholique est l’unique détentrice des moyens de salut, l’assertion du document conciliaire est proche de l’hérésie : si, en leur accordant une « signification et une valeur dans le mystère du salut [101] », elle reconnaît à ces communautés séparées une quasi-légitimité – ainsi que le laisse entendre l’expression “Églises-sœurs” [102]– elle va dans un sens opposé à la doctrine catholique parce qu’elle nie l’unicité de l’Église catholique.
Ce qui nous unit est-il plus grand que ce qui nous sépare ?
29. La proposition reste vraie matériellement, en ce sens que tous ces éléments sont autant de points pouvant servir de base à des discussions visant à les ramener dans l’unique bercail. Si les Communautés séparées ne sont pas formellement détentrices des éléments de sanctification et de vérité – ainsi qu’il a été dit plus haut – la proposition selon laquelle « ce qui unit les catholiques aux dissidents est plus grand que ce qui les sépare » ne peut être vraie formellement, et c’est pourquoi saint Augustin dit : « En beaucoup de points ils sont avec moi, en quelques-uns seulement ils ne sont pas avec moi ; mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de moi, il ne leur sert de rien d’être avec moi en tout le reste. [103] »
Conclusion
30. L’œcuménisme ne peut être que rapproché de la “théorie des branches” [104] condamnée par le Magistère : « Son fondement […] est tel qu’il renverse de fond en comble la constitution divine de l’Église » et sa prière pour l’unité, selon « une intention profondément souillée et infectée par l’hérésie, ne peut absolument pas être toléré [e]. [105] »
Chapitre III. Les problèmes pastoraux posés par l’œcuménisme
31. Outre le fait qu’il s’appuie sur des thèses hétérodoxes, l’œcuménisme est nocif pour les âmes, en ce sens qu’il relativise la foi catholique pourtant indispensable au salut et qu’il détourne de l’Église catholique, unique arche de salut. L’Église catholique n’agit plus en phare de la vérité qui illumine les cœurs et dissipe l’erreur, mais plonge l’humanité dans la brume de l’indifférentisme religieux, et bientôt dans les ténèbres de l’« apostasie silencieuse [106] »
L’Œcuménisme engendre le relativisme de la foi
Il relativise les déchirures opérées par les hérétiques
32. Le dialogue œcuménique voile le péché contre la foi que commet l’hérétique – raison formelle de la rupture – pour mettre en avant le péché contre la charité, imputé arbitrairement tant à l’hérétique qu’au fils de l’Église. Il en arrive finalement à nier le péché contre la foi que constitue l’hérésie. C’est ainsi que Jean-Paul II, au sujet de l’hérésie monophysite, affirme : « Les divisions qui se sont produites étaient dues dans une large mesure à des malentendus [107] », ajoutant : « Les formulations doctrinales qui se séparent des formules en usage […] recouvrent un contenu identique. [108] » De telles affirmations désavouent d’autant le Magistère pourtant infaillible qui condamna ces hérésies.
Il prétend que la foi de l’Église peut être perfectionnée par les “richesses” de l’autre
33. Même si le concile Vatican II précise, quoiqu’en des termes bien modérés, la nature de l’ “enrichissement” apporté par le dialogue – « une connaissance plus conforme à la vérité, en même temps qu’une estime plus juste, de l’enseignement et de la vie de chaque communion [109] » – la pratique œcuménique de ce pontificat déforme cette affirmation pour en faire un enrichissement de la foi. L’Église quitte un regard partiel pour saisir la réalité intégralement : « Les polémiques et les controverses intolérantes ont transformé en affirmations incompatibles ce qui était en fait le résultat de deux regards scrutant la même réalité, mais de deux points de vue différents. Il faut trouver aujourd’hui la formule qui, saisissant cette réalité intégralement, permette de dépasser des lectures partielles et d’éliminer des interprétations erronées. [110] » C’est ainsi que « l’échange des dons entre Églises, dans leur complémentarité, rend féconde la communion. [111] » De telles affirmations, si elles présupposent que l’Église n’est pas définitivement et intégralement dépositaire du trésor de la foi, ne sont pas conformes à la doctrine traditionnelle de l’Église. C’est pourquoi le Magistère mettait en garde contre cette fausse valorisation des supposées richesses de l’autre : « En revenant à l’Église, ils ne perdront rien du bien qui, par la grâce de Dieu, est réalisé en eux jusqu’à présent, mais par leur retour ce bien sera plutôt (potius) complété et amené à la perfection. On évitera pourtant de parler sur ce point d’une manière telle que, en revenant à l’Église, ils s’imaginent apporter à celle-ci un élément essentiel qui lui aurait manqué jusqu’ici. [112] »
Il relativise l’adhésion à certains donnés de la foi
34. La supposée « hiérarchie des vérités de la doctrine catholique [113] » est certes bien resituée théologiquement par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : elle « signifie que certains dogmes ont leur raison d’être en d’autres qui occupent le premier rang et les éclairent. Mais tous les dogmes puisqu’ils sont révélés, doivent également être crus de foi divine. [114] » Cependant, la pratique œcuménique de Jean-Paul II s’affranchit de cette interprétation authentique. Par exemple dans l’adresse à l’ “Église” évangélique, il souligne “ce qui importe” : « Vous savez que, pendant des dizaines d’années, ma vie a été marquée par l’expérience des défis lancés au christianisme par l’athéisme et l’incroyance. J’ai d’autant plus clairement devant les yeux ce qui importe : notre commune profession de Jésus-Christ. […] Jésus-Christ est notre salut à tous. […] Par la force de l’Esprit-Saint, nous devenons ses frères, véritablement et essentiellement des fils de Dieu. […] Grâce à la réflexion sur la Confession d’Augsbourg et à de multiples rencontres, nous avons pris une nouvelle conscience du fait que nous croyons et professons tout cela ensemble. [115] » Léon XIII condamnait ce type de pratique œcuménique, qui trouve son apogée dans la déclaration sur la Justification : « Ils soutiennent qu’il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de relativiser certains points de doctrine comme étant de moindre importance, ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l’Église s’est toujours tenue. Il n’est pas besoin de long discours pour montrer combien est condamnable une telle conception. [116] »
Il promeut une “réforme permanente” des formules de foi
35. La latitude que la pratique œcuménique s’octroie avec les formules dogmatiques a déjà été dite. Reste à montrer l’importance de ce procédé dans le processus œcuménique : « L’approfondissement de la communion dans une réforme constante, réalisée à la lumière de la Tradition apostolique, est sans doute un des traits distinctifs les plus importants de l’œcuménisme. […] Le décret sur l’œcuménisme (UR nº 6) fait figurer la manière de formuler la doctrine parmi les éléments de réforme permanente. [117] » Un tel procédé a été condamné par Pie XII : « Certains entendent réduire le plus possible la signification des dogmes et libérer le dogme lui-même de la manière de s’exprimer en usage dans l’Église depuis longtemps et des concepts philosophiques en vigueur chez les docteurs catholiques. […] Il est clair […] que ces tentatives non seulement conduisent à ce qu’ils appellent un “relativisme” dogmatique, mais qu’elles le contiennent déjà en fait. […] Certes, il n’est personne qui ne voie que les termes pour exprimer de telles notions, et qui sont utilisés dans les écoles [théologiques] aussi bien que par le magistère de l’Église lui-même, peuvent être améliorés et perfectionnés. […] Il est clair également que l’Église ne peut pas se lier à n’importe quel système philosophique, dont le règne ne dure que peu de temps : mais ce qui durant des siècles a été établi du consentement commun des docteurs catholiques pour parvenir à une certaine intelligence du dogme, ne repose assurément pas sur un fondement aussi fragile. […] C’est pourquoi il n’y a pas lieu de s’étonner si certaines de ces notions, les conciles œcuméniques ne les ont pas seulement employées, mais qu’ils les ont également sanctionnées, en sorte qu’il n’est pas permis de s’en éloigner. [118] »
Il refuse d’enseigner sans ambiguïté le contenu intégral de la foi catholique
36. Le postulat œcuménique selon lequel « la méthode et la manière d’exprimer la foi catholique ne doivent nullement faire obstacle au dialogue avec les frères [119] » aboutit à des déclarations communes signées solennellement, mais équivoques et ambivalentes. Dans la déclaration commune sur la Justification par exemple, jamais n’est enseignée clairement l’infusion de la grâce sanctifiante [120] dans l’âme du juste ; la seule phrase y faisant allusion, des plus maladroites, peut même porter à croire l’inverse : « La grâce justifiante ne devient jamais une possession de la personne dont cette dernière pourrait se réclamer face à Dieu. [121] » De telles pratiques ne respectent plus le devoir d’exposer intégralement et sans ambiguïté la foi catholique, comme “devant être crue” : « La doctrine catholique doit être proposée totalement et intégralement ; il ne faut point passer sous silence ou voiler en des termes ambigus ce que la vérité catholique enseigne sur la vraie nature et les étapes de la justification, sur la constitution de l’Église, sur la primauté de juridiction du Pontife Romain, sur la seule véritable union par le retour des chrétiens séparés à l’unique véritable Église du Christ. [122] »
Il met sur un pied d’égalité les saints authentiques et les “saints” supposés
37. En publiant un martyrologe commun aux différentes confessions chrétiennes, Jean-Paul II met sur un pied d’égalité les saints authentiques avec des “saints” supposés. C’est oublier la phrase de saint Augustin : « Si, restant séparé de l’Église, il est persécuté par un ennemi du Christ […] et que cet ennemi du Christ lui dise à lui, séparé de l’Église du Christ : “Offrez de l’encens aux idoles, adorez mes dieux” et le tue parce qu’il ne les adore pas, il pourra répandre son sang, mais non recevoir la couronne. [123] » Si l’Église espère pieusement que le frère séparé mort pour le Christ a eu la charité parfaite, elle ne peut l’affirmer. Dans son droit, elle présume que l’ “obex”, l’obstacle de la séparation visible, fut un obstacle à l’acte de charité parfaite que constitue le martyre. Elle ne peut donc le canoniser ni l’inscrire au martyrologe [124] .
Il provoque donc la perte de la foi
38. Relativiste, évolutionniste et ambigu, cet œcuménisme provoque directement la perte de la foi. La première victime en est le Président du Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens, le cardinal Kasper lui-même, lorsqu’il affirme par exemple au sujet de la justification que « notre valeur personnelle ne dépend pas de nos œuvres, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Avant même d’agir, nous sommes acceptés et nous avons reçu le “oui” de Dieu [125] ; ou encore à propos de la messe et du sacerdoce, que « ce n’est pas le prêtre qui opère la transsubstantiation : le prêtre prie le Père afin que celle-ci ait lieu par l’opération du Saint Esprit. […] La nécessité du ministère ordonné est un signe qui suggère et fait aussi goûter la gratuité du sacrement eucharistique. [126] »
L’Œcuménisme détourne de l’Église
39. Outre qu’il détruit la foi catholique, l’œcuménisme détourne encore de l’Église les hérétiques, les schismatiques et les infidèles.
Il ne réclame plus la conversion des hérétiques et schismatiques
40. Le mouvement œcuménique ne cherche plus leur conversion et leur retour à « l’unique bercail du Christ, hors duquel se trouve certainement quiconque n’est point uni à ce Saint-Siège de Pierre. [127] » Cela est clairement affirmé : « Nous le rejetons [l’uniatisme] comme méthode de recherche d’unité. […] L’action pastorale de l’Église catholique tant latine qu’orientale ne tend plus à faire passer les fidèles d’une Église à l’autre. [128] » D’où la suppression de la cérémonie d’abjuration en cas de retour d’un hérétique à l’Église catholique. Le cardinal Kasper va très loin dans ce type d’affirmations : « L’œcuménisme ne se fait pas en renonçant à notre propre tradition de foi. Aucune Église ne peut pratiquer ce renoncement. [129] » Il ajoute encore : « Nous pouvons décrire l’ “ethos” propre à l’œcuménisme de vie de la façon suivante : renoncement à toute forme de prosélytisme ouvert ou camouflé. [130] » Tout cela est radicalement opposé à la pratique constante des papes à travers les siècles, qui ont toujours œuvré au retour des dissidents à l’unique Église [131].
Il engendre un égalitarisme entre les confessions chrétiennes
41. La pratique œcuménique engendre un égalitarisme entre les catholiques et autres chrétiens, lorsque par exemple Jean-Paul II se réjouit du fait que, « à l’expression frères séparés, l’usage tend à substituer aujourd’hui des termes plus aptes à évoquer la profondeur de la communion liée au caractère baptismal. […] La conscience de l’appartenance commune au Christ s’approfondit. […] La “fraternité universelle” des chrétiens est devenue une ferme conviction œcuménique. [132] » Plus encore, c’est l’Église catholique elle-même qui, pratiquement, est mise à pied d’égalité avec les Communautés séparées : nous avons déjà mentionné l’expression “Églises-sœurs” ; Jean-Paul II se réjouit également de ce que « le Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme appelle les Communautés auxquelles appartiennent ces chrétiens des “Églises et [des] Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique”. […] Reléguant dans l’oubli les excommunications du passé, les Communautés, un temps rivales, s’aident aujourd’hui mutuellement. [133] » Se réjouir de cela, c’est oublier que « reconnaître la qualité d’Église au schisme de Photius et à l’Anglicanisme […] favorise l’indifférentisme religieux […] et arrête la conversion des non-catholiques à la véritable et unique Église. [134] »
Il humilie l’Église et enorgueillit les dissidents
42. La pratique œcuménique des repentances dissuade les infidèles de se tourner vers l’Église catholique, en raison de la fausse image qu’elle y donne d’elle-même. S’il est possible de porter devant Dieu la faute de ceux qui nous ont précédés [135], en revanche la pratique des repentances telle que nous la connaissons laisse croire que c’est l’Église catholique en tant que telle qui est pécheresse, puisque c’est elle qui demande pardon. Le premier à le croire est le cardinal Kasper : « Il [le concile Vatican II] reconnut que l’Église catholique avait une responsabilité dans la division des chrétiens et souligna que le rétablissement de l’unité supposait une conversion des uns et des autres au Seigneur. [136] » Les textes justificatifs n’y font donc rien : la note ecclésiale de sainteté, si puissante pour attirer les âmes égarées à l’unique bercail, a été ternie. Ces repentances sont donc gravement imprudentes, car elles humilient l’Église catholique et enorgueillissent les dissidents. D’où la mise en garde du Saint-Office : « Ils [les évêques] empêcheront soigneusement et avec une réelle insistance qu’en exposant l’histoire de la Réforme et des Réformateurs, on n’exagère tellement les défauts des catholiques et on ne dissimule tellement les fautes des Réformateurs ou bien qu’on mette tellement en lumière des éléments plutôt accidentels que l’on ne voie et ne sente presque plus ce qui est essentiel, la défection de la foi catholique. [137] »
Conclusion
43. Considéré sous l’angle pastoral, on doit dire de l’œcuménisme de ces dernières décennies qu’il mène les catholiques à l’« apostasie silencieuse » et qu’il dissuade les non-catholiques d’entrer dans l’unique arche de salut. Il faut donc réprouver « l’impiété de ceux qui ferment aux hommes l’entrée du Royaume des cieux. [138] » Sous couvert de rechercher l’unité, cet œcuménisme disperse les brebis ; il ne porte pas la marque du Christ, mais celle du diviseur par excellence, le diable.
Conclusion générale
44. Si attirant qu’il puisse paraître au premier abord, si spectaculaires que puissent apparaître ses cérémonies à la télévision, aussi nombreuses que puissent être les foules qu’il rassemble, la réalité demeure : l’œcuménisme a fait de cette cité sainte qu’est l’Église une ville en ruine. Marchant à la suite d’une utopie – l’unité du genre humain – le pape n’a pas réalisé combien l’œcuménisme qu’il poursuivait était proprement et tristement révolutionnaire : il renverse l’ordre voulu par Dieu.
45. Révolutionnaire il l’est, révolutionnaire il s’affirme. On reste impressionné par la succession des textes le rappelant : « L’approfondissement de la communion dans une réforme constante […] est sans doute un des traits distinctifs les plus importants de l’œcuménisme. [139] » « En reprenant l’idée que le Pape Jean XXIII avait exprimée à l’ouverture du concile, le Décret sur l’œcuménisme fait figurer la manière de reformuler la doctrine parmi les éléments de la réforme permanente. [140] » Par moments, cette affirmation se pare d’onction ecclésiastique pour devenir “conversion”. En l’occurrence, la différence importe peu. Dans les deux cas, ce qui préexistait est rejeté : « “Convertissez-vous”. Il n’est aucun rapprochement œcuménique sans conversion et sans renouvellement. Non la conversion d’une confession à l’autre. […] Tous doivent se convertir. Nous ne devons donc pas demander d’abord “Qu’est-ce qui ne va pas avec l’autre ?”, mais “Qu’est-ce qui ne va pas chez nous ; par où commencer, chez nous, le ménage ?” [141] » Trait caractéristique de son aspect révolutionnaire, l’appel au peuple que clame cet œcuménisme : « Dans l’action œcuménique, les fidèles de l’Église catholique […] considéreront surtout avec loyauté et attention tout ce qui, dans la famille catholique elle-même, a besoin d’être rénové. [142] » Oui, vraiment, en cette ivresse d’aggiornamento, la tête a besoin d’être dépassée par les membres : « Le mouvement œcuménique est un processus quelque peu complexe, et ce serait une erreur de s’attendre, du côté catholique, à ce que tout soit fait par Rome. […] Les intuitions, les défis doivent aussi venir des Églises locales, et beaucoup doit être fait au niveau local avant que l’Église universelle le fasse sien. [143] »
46. Comment, en ces tristes circonstances, ne pas entendre le cri de l’Ange à Fatima : « Pénitence, Pénitence, Pénitence » ? En cette marche utopique, le demi-tour doit être radical. Il est urgent de revenir à la sage expérience de l’Église, synthétisée ici par le Pape Pie XI : « L’union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu’en favorisant le retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, qu’ils ont eu jadis le malheur d’abandonner. [144] » Telle est la véritable et charitable pastorale à l’endroit des égarés, telle doit être la prière de l’Église : « Nous désirons que monte vers Dieu la commune supplication de tout le Corps mystique [c’est-à-dire de toute l’Église catholique] afin que toutes les brebis errantes rejoignent au plus tôt l’unique bercail de Jésus-Christ. [145] »
47. En attendant l’heure heureuse de ce retour à la raison, nous gardons pour notre part le sage avis et la ferme sagesse reçus de notre fondateur : « Nous voulons être dans une unité parfaite avec le Saint-Père, mais dans l’unité de la foi catholique, parce qu’il n’y a que cette unité qui peut nous réunir, et non pas une espèce d’union œcuménique, une sorte d’œcuménisme libéral ; car je crois que ce qui définit le mieux toute la crise de l’Église, c’est vraiment cet esprit œcuménique libéral. Je dis œcuménisme libéral, parce qu’il y a un certain œcuménisme qui, s’il est bien défini, pourrait être acceptable. Mais l’œcuménisme libéral, tel qu’il est pratiqué par l’Église actuelle et surtout depuis le concile Vatican II, comporte nécessairement de véritables hérésies [146]. » Faisant de surcroît monter notre supplication vers le Ciel, nous implorons le Christ pour son Corps qu’est l’Église catholique, en disant : « Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum. Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum : labia dolosa in corde et corde locuti sunt. Disperdat Dominus universa labia dolosa et linguam magniloquam. [147] »
- Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, n° 7 et 9, La documentation catholique n° 2296 du 20 juillet 2003, p. 668 ss.[↩]
- W. Kasper, The Tablet, Saturday, 24 May 2003, May They All Be One ? but how ? A Vision of Christian Unity for the Next generation.[↩]
- Pie XI Mortalium animos du 6 janvier 1928, AAS 20 (1928), p. 7.[↩]
- Ibid. p. 14.[↩]
- Jean-Paul II, Allocution au secrétariat pour l’unité des chrétiens du 18 nov. 1978, La documentation catholique (DC) nº 1753 du 03 déc. 1978 p. 1017.[↩]
- Jean-Paul II, Angélus du 17 janv. 1982, DC nº 1823 du 7 fév. 1982, p. 144.[↩]
- Jean-Paul II, 1er message au monde du 17 oct. 1978, DC nº 1751 du 5 nov. 1978, p. 902-903.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, nº 1.[↩]
- Jean-Paul II, 1er message au monde du 17 oct. 1978, DC nº 1751 du 05 nov. 1978, p. 903.[↩]
- Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 24. Cf. Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 42 : « Les célébrations œcuméniques sont parmi les événements les plus importants de mes voyages apostoliques dans les différentes parties du monde. »[↩]
- Jean-Paul II, Homélie à l’ouverture de la Porte Sainte à Saint-Paul-hors-les-Murs du 18/01/2000, DC nº 2219 du 06/02/2000, p. 106 : « La Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens commence aujourd’hui à Rome avec la célébration qui nous voit réunis. J’ai voulu qu’elle coïncide avec l’ouverture de la Porte Sainte dans cette basilique consacrée à l’Apôtre des nations, pour souligner la dimension œcuménique qui doit caractériser l’Année jubilaire 2000. »[↩]
- Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 34.[↩]
- Jean-Paul II, Redemptor hominis, nº 1.[↩]
- Jean-Paul II, Homélie prononcée en présence du Patriarche œcuménique de Constantinople Dimitrios 1er le 29/11/1979 à Istanbul, DC nº 1776 du 16/12/1979, p. 1056.[↩]
- Jean-Paul II, Message pour la XVe Rencontre internationale de prière pour la paix, DC nº 2255 du 07/10/2001, p. 818.[↩]
- Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, nº 7, DC nº 2296 du 20/07/2003, p. 670-671.[↩]
- Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, nº 7 & 9, DC nº 2296 du 20/07/2003, p. 671672.[↩]
- Jean-Paul II, La situation du monde et l’esprit d’Assise, Discours aux cardinaux et à la Curie du 22/12/1986, DC nº 1933 du 01/02/1987, p. 134.[↩]
- Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 6.[↩]
- Jean-Paul II, Redemptor hominis nº 13.[↩]
- Jean-Paul II, Message aux peuples d’Asie du 21/02/1981, DC nº 1804 du 15/03/1981, p. 281.[↩]
- Jean-Paul II, La situation du monde et l’esprit d’Assise, discours aux cardinaux et à la Curie du 22/12/1986, DC nº 1933 du 01/02/1987, p. 134.[↩]
- Jean-Paul II, ibid.[↩]
- Jean-Paul II, ibid., p. 133.[↩]
- Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 6.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint nº 42 : « L’usage tend à substituer aujourd’hui des termes plus aptes à exprimer la profondeur de la communion - liée au caractère baptismal -, que l’Esprit nourrit malgré les ruptures historiques et canoniques. »[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3 : « Parmi les éléments ou les biens par l’ensemble desquels l’Église se construit et est vivifiée, plusieurs et même beaucoup, et de grande valeur, peuvent exister en dehors des limites visibles de l’Église catholique. […] Tout cela, qui provient du Christ et conduit à lui, appartient de droit à l’unique Église du Christ. » C’est en raison de cette affirmation que LG nº 8 dit de l’Église du Christ qu’elle “subsiste dans” l’Église catholique, et non qu’elle “est” l’Église catholique. Cf. commentaire du cardinal Ratzinger, L’ecclésiologie de la Constitution conciliaire Lumen Gentium, conférence du 27/02/2000, DC nº 2223 du 02/04/2000, p. 310-311 : « Par cette expression, le Concile se différencie de la formule de Pie XII qui avait dit dans son Encyclique Mystici Corporis : l’Église catholique “est” (est, en latin) cependant l’unique corps mystique du Christ. […] La différence entre “subsistit” et “est” renferme le drame de la division ecclésiale. Bien que l’Église soit seulement une et subsiste en un unique sujet, des réalités ecclésiales existent en dehors de ce sujet : de véritables Églises locales et diverses Communautés ecclésiales. »[↩]
- Cette affirmation découle directement de la manière dont Lumen Gentium (nº 7 et 8) présente l’Église. Jusque là, le Magistère la tirait de l’analogie paulinienne selon laquelle l’Église est le corps du Christ ; corps, donc visible : « Parce qu’elle est un corps, l’Église est visible à nos regards. » (Léon XIII, Satis cognitum, DzH 3300). Or le concile refuse de faire ce lien : il traite séparément de l’Église corps du Christ (LG, nº 7) et de la visibilité de l’Église catholique (LG, nº 8). C’est laisser entendre que l’Église corps du Christ [l’Église du Christ] n’est pas de soi quelque chose de visible. Certes, LG nº 8 affirme l’union nécessaire de l’Église du Christ et de l’Église organique : « La société douée d’organes hiérarchiques [Église catholique] et le Corps mystique du Christ [Église du Christ], l’assemblée visible [Église catholique] et la communauté spirituelle [Église du Christ], l’Église de la terre [Église catholique] et l’Église si riche en biens célestes [Église du Christ], ne doivent pas être considérés comme deux réalités, mais forment une seule réalité complexe. » Mais cette affirmation n’est pas suffisante : l’union de deux choses distinctes – l’Église du Christ et l’Église organique – n’est pas l’affirmation de l’unité propre à l’Église. Cette unité est au contraire refusée, lorsqu’il est dit de l’Église du Christ qu’elle « subsiste dans l’Église catholique » : le rapport de contenant à contenu n’est pas celui de l’identité, surtout lorsqu’il est affirmé que l’Église du Christ se rend présente de manière agissante ailleurs que dans ce contenu parfait qu’est l’Église catholique. En conséquence de cette affirmation et dans la suite de LG nº 15, Jean-Paul II affirme souvent que le baptisé, quelle que soit son appartenance ecclésiale est et demeure uni au Christ, incorporé à lui. Cette théorie affirmant l’intériorité de l’Église du Christ est tellement répandue que des cardinaux aussi différents que J. Ratzinger et W. Kasper la rappellent comme une évidence : « “L’Église se réveille dans les âmes” : Cette phrase de Guardini avait été longuement mûrie. En effet, elle montra que l’Église était finalement reconnue et vécue comme quelque chose d’intérieur, qui n’existe pas face à nous comme une institution quelconque mais qui vit en nous-mêmes. Si, jusqu’alors, l’Église avait été considérée tout d’abord comme une structure et une organisation, on prit finalement conscience que nous étions nous-mêmes l’Église. Elle était beaucoup plus qu’une organisation : elle était l’organisme de l’Esprit Saint, quelque chose de vital, qui nous saisit tous dans notre intimité. Cette nouvelle conscience de l’Église trouva son expression linguistique dans le concept de “corps mystique du Christ” » (J. Ratzinger, L’ecclésiologie de Vatican II, conférence donnée le 15/09/2001 à l’occasion de l’ouverture du Congrès pastoral du diocèse d’Aversa) ; « La véritable nature de l’Église – l’Église en tant que Corps du Christ – est cachée, et elle n’est saisissable que par la foi. Mais cette nature saisissable uniquement par la foi, s’actualise sous des formes visibles. » (W. Kasper, L’engagement œcuménique de l’Église catholique, conférence du 23/03/2002 à l’assemblée générale de la fédération de France, Œcuménisme informations nº 325 de mai 2002 et 326 de juin 2002.[↩]
- “Pour le moins” : Karol Wojtyla est allé en effet beaucoup plus loin, à l’occasion de la retraite qu’il a prêchée au Vatican alors qu’il n’était que cardinal : « Dieu de Majesté infinie ! le trappiste ou le chartreux confesse ce Dieu par toute une vie de silence. C’est vers lui que se tourne le bédouin pérégrinant dans le désert quand vient l’heure de la prière. Et ce moine bouddhiste se concentre dans sa contemplation qui purifie son esprit en l’orientant vers le Nirvana : mais est-ce seulement du côté du Nirvana ? […] L’Église du Dieu vivant réunit justement en elle ces gens qui de quelque manière participent à cette transcendance à la fois admirable et fondamentale de l’esprit humain. » (Karol Wojtyla, Le signe de contradiction, Ed. Fayard 1979, p. 31-32[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 42.[↩]
- Jean-Paul II, ibid.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 9.[↩]
- Congrégation pour la Doctrine de la foi, Lettre sur certains aspects de l’Église comprise comme Communion, nº 6, DC nº 2055 du 02/08/1992, p. 730.[↩]
- Cf. Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (approuvé par Jean-Paul II le 25/03/1993), nº 13, DC nº 2075 du 04/07/1993, p. 611.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 11.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3 : « Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, avec l’Église catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l’Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l’Église, constituent nombre d’obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. » Voilà pour ce qui concerne la communion visible partiellement brisée ; mais le décret ajoute aussitôt, afin de montrer la permanence de la communion invisible : « Néanmoins, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l’Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. […] De même, chez nos frères séparés s’accomplissent beaucoup d’actions sacrées de la religion chrétienne qui, de manières différentes selon la situation diverse de chaque Église ou communauté, peuvent certainement produire effectivement la vie de la grâce, et l’on doit reconnaître qu’elles donnent accès à la communion du salut. »[↩]
- Cf. Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 56, 57 et 60 ; Allocution dans la basilique Saint-Nicolas de Bari du 26/02/1984, DC nº 1872 du 15/04/1984, p. 414 ; Déclaration christologique commune entre l’Église catholique et l’Église assyrienne d’Orient, DC nº 2106 du 18/12/1994, p. 1070 ; Homélie prononcée en présence du Patriarche œcuménique de Constantinople Dimitrios 1er le 29/11/1979 à Istanbul, DC nº 1776 du 16/12/1979, p. 1056 : « Je vous invite à prier avec ferveur pour la pleine communion de nos Églises. […] Suppliez le Seigneur pour que nous-mêmes, pasteurs des Eglises-sœurs, nous soyons les meilleurs instruments en cette heure de l’Histoire, pour régir ces Églises, c’est-à-dire pour les servir comme le veut le Seigneur, et servir ainsi l’unique Église qui est son Corps. »[↩]
- Cf. Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 16.[↩]
- Jean-Paul II, Discours à la délégation de la Fédération luthérienne mondiale du 09/12/1999, DC nº 2219 du 06/02/2000, p. 109.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, nº 8 ; Décr. Unitatis redintegratio, nº 4 ; Décl. Dignitatis humanæ, nº 1.[↩]
- Cardinal Ratzinger, L’ecclésiologie de la Constitution conciliaire Lumen Gentium, conférence du 27/02/2000, DC nº 2223 du 02/04/2000, p. 311.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3 ; Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 11[↩]
- Jean-Paul II, Tertio millennio adveniente, nº 37.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 77.[↩]
- On entend par “œcuménisme de retour” celui rappelé par Pie XI dans l’encycl. Mortalium animos : « Pousser au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu’ils ont eu jadis le malheur de s’en séparer. Le retour à l’unique véritable Église, disons-Nous, bien visible à tous les regards. »[↩]
- Déclaration de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe du 23/06/1993, dite “de Balamand”, nº 2 et 22, DC nº 2077 du 01–15/08/1993, p. 713. Cette citation ne concerne que l’uniatisme, mais le cardinal Kasper aura des formules systématiques : « Le vieux concept d’œcuménisme du retour a été remplacé aujourd’hui par celui d’itinéraire commun, qui dirige les chrétiens vers le but de la communion ecclésiale comprise comme unité dans la diversité réconciliée » (W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 167).[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3 : « Apparurent certaines scissions, […] naquirent des dissensions plus graves, […] parfois par la faute des personnes de l’une ou de l’autre partie ». D’où la nature de la conversion réclamée par UR, nº 7 : « Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En effet, c’est du renouveau de l’âme, du renoncement à soi-même et d’une libre effusion de la charité que partent et mûrissent les désirs de l’unité. » Cf. Cardinal Kasper, Conférence au Kirchentag œcuménique de Berlin, DC nº 2298 du 07-21/09/2003 : « “Convertissez-vous”. Il n’est aucun rapprochement œcuménique sans conversion et sans renouvellement. Non la conversion d’une confession à l’autre. Il peut y en avoir dans des cas particuliers, et si c’est pour des raisons de conscience, cela mérite respect et considération. Mais il n’y a pas que les autres à devoir se convertir, la conversion commence par soi-même. Tous doivent se convertir. Nous ne devons donc pas demander d’abord “Qu’est-ce qui ne va pas avec l’autre ?”, mais “Qu’est-ce qui ne va pas chez nous ; par où commencer, chez nous, le ménage ?” »[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 11 ; cf. nº 34.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, nº 13 ; cf. Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 28.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 57.[↩]
- Jean-Paul II, Allocution dans la basilique Saint-Nicolas de Bari du 26/02/1984, prononcée en présence du métropolite de Myre, Konstantinidis (patriarcat de Constantinople), DC nº 1872 du 15/04/1984, p. 414.[↩]
- Ibid.[↩]
- Jean-Paul II, Angélus du 17/01/1982, DC nº 1823 du 07/02/1982, p. 144.[↩]
- A. Bugnini, Modifications aux oraisons solennelles du Vendredi Saint, DC nº 1445 du 04/03/1965, col. 603. Cf. G. Celier, La dimension œcuménique de la réforme liturgique, Editions Fideliter, 1987, p. 34.[↩]
- Cf. l’ Osservatore Romano italien du 26/10/2001. Admission à l’Eucharistie entre l’Église chaldéenne et l’Église assyrienne d’Orient, Note et orientations du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, DC nº 2265, du 03/03/2002, p. 214.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 38.[↩]
- Jean-Paul II, citant dans Ut unum sint, nº 38 la Déclaration Mysterium Ecclesiæ de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (DC nº 1636 du 15/07/1973, p. 267).[↩]
- Déclaration christologique commune entre l’Église catholique et l’Église assyrienne d’Orient, DC nº 2106 du 18/12/1994, p. 1069.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 38.[↩]
- DC nº 2106 du 18/12/1994, p. 1069. Cf. DzH, nº 251d et 252.[↩]
- Déclaration commune de la Fédération luthérienne mondiale et de l’Église catholique, nº 7 (cf. nº 5, 13, 40 à 42), DC nº 2168 du 19/10/1997, p. 875.[↩]
- W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 172.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 95.[↩]
- La primauté du successeur de Pierre dans le mystère de l’Église, réflexions de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, DC nº 2193 du 06/12/1998 p. 1018.[↩]
- Léon XIII, Lettre apostolique Apostolicæ curæ du 13/09/1896.[↩]
- W. Kasper, May They All Be One ? But how ? A Vision of Christian Unity for the Next Generation, The Tablet du 24/05/2003.[↩]
- Nous limitant ici à la seule réfutation de l’œcuménisme, nous n’étudierons pas l’enseignement de Jean-Paul II relatif à la rédemption accomplie de fait en chaque personne et en chaque peuple. Nous dirons simplement qu’une telle proposition est totalement étrangère à la foi catholique et la ruine de fond en comble (que devient par exemple la nécessité du baptême ?).[↩]
- Calvin, Inst., l. 4, c. 4.[↩]
- Léon XIII, encycl. Satis cognitum, DzH nº 3300 ss.[↩]
- Pie XI, encycl. Mortalium animos, AAS 20 (1928), p. 8. Enseignements Pontificaux de Solesmes, L’Église, (EP) vol. 1, nº 861.[↩]
- Pie XII, encycl. Mystici Corporis, AAS 35 (1943), p. 199-200. EP, vol. 2, nº 1015.[↩]
- Pie XII, encycl. Mystici Corporis, Ibid., p. 199. EP, vol. 2, nº 1014.[↩]
- Lettre du Saint-Office aux évêques d’Angleterre du 16/09/1864, DzH nº 2888.[↩]
- Pie IX, Allocution au consistoire du 18/07/1861, EP, vol. 1, nº 230.[↩]
- Schéma réformé du concile Vatican I sur l’Église, can. 4, Mansi, 53, 316.[↩]
- W. Kasper, L’engagement œcuménique de l’Église catholique, conférence du 23/03/2002 à l’assemblée générale de la Fédération protestante de France, Œcuménisme informations nº 325 (05/2002) et 326 (06/2002).[↩]
- W. Kasper, ibid.[↩]
- Ce triple lien doit, redisons-le, être possédé soit de fait, soit au moins « par un certain désir ou vœu inconscient » (Cf. Pie XII, Mystici Corporis, AAS 35 (1943), p. 243. DzH 3821). Mais de ce désir, l’Église n’est pas juge. En matière juridique – ce qui est le cas ici – l’Église ne peut juger des réalités intérieures à la conscience de chacun, mais seulement de ce qui apparaît : « De l’état d’esprit et de l’intention, parce que ce sont choses intérieures, l’Église ne juge pas ; mais en tant qu’ils paraissent au dehors, elle doit en juger » (Léon XIII, Lettre apostolique Apostolicæ curæ du 13/09/1896 sur la nullité des ordinations anglicanes, ASS 29 (1896-1897), p. 201. DzH 3318). Dès lors, même si, dans sa pastorale, comme une bonne mère, elle incline à espérer leur appartenance “de désir au moins inconscient” lorsqu’elle les approche quand ils se trouvent dans le péril de mort (Dom. M. Prümmer, o.p., Manuale theologiæ moralis, T. 1, nº 514, 3), cependant, juridiquement, l’Église ne le présume pas en temps normal. C’est pourquoi elle a toujours exigé, ad cautelam, leur abjuration du schisme ou de l’hérésie lorsqu’ils reviennent à l’Église catholique (Cf. CIC 1917, can. 2314, § 2). A plus forte raison ne présume-t-elle pas la bonne foi des dissidents considérés en corps constitué, en communauté visiblement séparée de l’Église catholique, ainsi que l’envisage l’œcuménisme. Ce que nous disons des trois éléments nécessaires à l’appartenance à l’Église catholique suppose la présomption susdite. Vouloir l’élider serait se mouvoir dans l’incertain et l’irréel.[↩]
- He 11, 6 : « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »[↩]
- Saint Pie X, Pascendi dominici gregis : « La foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin… Telle est, pour les modernistes, la foi, et dans la foi ainsi entendue, le commencement de toute religion » (Acta S. Pii X 4 (1907), p. 52 ; DzH 3477 ne cite pas intégralement). Cette brève description est à comparer avec la pensée de Karol Wojtyla (Le signe de contradiction, Ed. Fayard 1979, p. 31-32) : « Dieu de Majesté infinie ! Le trappiste ou le chartreux confesse ce Dieu par toute une vie de silence. C’est vers lui que se tourne le bédouin pérégrinant dans le désert quand vient l’heure de la prière. Et ce moine bouddhiste se concentre dans sa contemplation qui purifie son esprit en l’orientant vers le Nirvana : mais est-ce seulement du côté du Nirvana ? […] L’Église du Dieu vivant réunit justement en elle ces gens qui de quelque manière participent à cette transcendance à la fois admirable et fondamentale de l’esprit humain, car elle sait que nul ne peut apaiser les plus profondes aspirations de cet esprit si ce n’est lui seul, le Dieu de majesté infinie. »[↩]
- Vatican I, sess. 3, c. 3, DzH nº 3008.[↩]
- Léon XIII, encycl. Satis cognitum du 29 juin 1896, ASS 28 (1895-1896), p. 722. EP, vol. 1, nº 573.[↩]
- Pie IX, encycl. Amantissimus du 8 avril 1862, EP, vol. 1, nº 234, puis 234 à 237.[↩]
- Cf. saint Ambroise, Epist. 11 ad imperatores.[↩]
- Cf. saint Cyprien, De Unitate Ecclesiæ.[↩]
- Cf. saint Jérôme, Epist. 51 ad Damasum.[↩]
- Saint Augustin, De baptismo contra donatistas, lib. 1, ch. 14, § 22.[↩]
- Mc 16, 16.[↩]
- Léon XIII, encycl. Satis cognitum, ASS 28 (1895-1896), p. 724. EP, vol. 1, nº 578.[↩]
- Pie IX, encycl. Amantissimus du 8 avril 1862, EP, vol. 1, nº 233.[↩]
- Pie XII, encycl. Mystici Corporis du 29 juin 1943, AAS 35 (1943), p. 203. DzH 3802.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3, dont nous citons ici le passage complet : « Ceux qui naissent aujourd’hui dans de telles communautés, et qui vivent de la foi au Christ, ne peuvent être accusés de péché de division, et l’Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, avec l’Église catholique. Assurément, des divergences variées entre eux et l’Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l’Église, constituent nombre d’obstacles, parfois fort graves, à la communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Néanmoins, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l’Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. »[↩]
- Cf. ci-dessus, note 74.[↩]
- Pie IX, Allocution Singulari Quadam du 09/12/1854, Dz 1647 (ancienne numérotation ; absent du DzH).[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, nº 8.[↩]
- Benoît XIV, Bref Singulari nobis du 9 fév. 1749, DzH nº 2566 à 2568.[↩]
- Concile de Florence, bulle Cantate Domino pour les jacobites, DzH 1351.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3.[↩]
- Saint Augustin, De baptismo contra donatistas, lib. 1, ch. 10, nº 14.[↩]
- Saint Augustin, De baptismo contra donatistas, lib. 1, ch. 14, nº 22.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 3.[↩]
- Cf. J. Ratzinger, L’ecclésiologie de la Constitution conciliaire Lumen Gentium, DC nº 2223 du 2/04/2000, p. 311. « Bien que l’Église soit seulement une et subsiste en un unique sujet, des réalités ecclésiales existent en dehors de ce sujet : de véritables Églises locales et diverses Communautés ecclésiales. ». C’est qu’en effet, « on y trouve des éléments essentiels à l’être-Eglise : l’annonce de la Parole de Dieu et le baptême, la présence active du Saint-Esprit, foi, espérance et charité, des formes de sainteté jusqu’au martyre. On peut parler d’une configuration différente de ces éléments ecclésiaux constitutifs, d’Églises d’un autre genre ou d’un autre type. » W. Kasper, L’engagement œcuménique de l’Église catholique, conférence du 23 mars 2002 lors de l’assemblée générale de la Fédération protestante de France, Œcuménisme informations nº 325 (05/2002) et 326 (06/2002).[↩]
- Saint Augustin, In Ps. 54, § 19, cité par Léon XIII (Satis cognitum) ASS 28 (1895-1896), p. 724. EP, vol. 1, nº 578.[↩]
- Lettre du Saint-Office aux évêques d’Angleterre du 16/09/1864. Cette théorie « professe expressément que trois communautés chrétiennes, la catholique romaine, la gréco-schismatique et l’anglicane, bien que séparées et divisées entre elles, revendiquent avec un même droit pour elles-mêmes le nom de catholique. […] Elle demande à tous ses membres de réciter des prières et aux prêtres d’offrir des sacrifices selon son intention : à savoir pour que les trois communions chrétiennes qui, comme il est suggéré, constituent toutes ensemble l’Église catholique, se réunissent enfin pour former un unique corps. » DzH 2885 & 2886.[↩]
- Ibid., DzH nº 2886 & 2887.[↩]
- Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, nº 9, DC nº 2296 du 20/07/2003, p. 668 ss.[↩]
- Déclaration christologique commune entre l’Église catholique commune et l’Église assyrienne d’Orient, DC nº 2106 du 18/12/1994, p. 1069.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 38.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 4.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 38.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 57. Cf. Cardinal Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 167 : « Il est apparu clairement que le but du dialogue ne consiste pas à faire changer le partenaire, mais à reconnaître nos propres manquements et à apprendre de l’autre. […] Là où nous avions vu au premier abord une contradiction, nous pouvons voir une position complémentaire. »[↩]
- Congrégation du Saint-Office, Instruction De motione œcumenica, du 20/12/1949, AAS 42 (1950), p. 144. DC nº 1064 du 12/03/1950, col. 332.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 11.[↩]
- Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Mysterium Ecclesiæ du 24/06/1973, DC nº 1636 du 15/07/1973, p. 667.[↩]
- Jean-Paul II, Rencontre avec le conseil de l’Église évangélique du 17/11/1980, DC nº 1798 du 21/12/1980, p. 1147.[↩]
- Léon XIII, encycl. Testem benevolentiæ du 22/01/1899, ASS 31 (1898-1899), p. 471 ; Actes de Léon XIII, La bonne presse, vol. 5, p. 313. Cf. Pie XI, Mortalium animos, AAS 28 (1920), p. 12 ; DzH nº 3683 : « S’agissant des points de foi, il n’est aucunement licite de distinguer d’une quelconque manière entre les points qui seraient fondamentaux et ceux qui ne le seraient pas, les premiers devant être acceptés de tous, et les autres pouvant être laissés au libre assentiment des croyants ; la vertu surnaturelle de foi a sa cause formelle dans l’autorité de Dieu révélant, qui ne tolère aucune distinction de ce type. »[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 17 et 18.[↩]
- Pie XII, encycl. Humani generis du 12/08/1950, AAS 42 (1950), p. 566-567, DzH 3881-83.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 11 ; Jean-Paul II, Ut unum sint nº 36.[↩]
- Cf. Concile de Trente, Décret sur la justification, ch. 7, DzH 1528 : « La justification elle-même [qui] n’est pas seulement rémission des péchés, mais à la fois sanctification et rénovation de l’homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et des dons. »[↩]
- Déclaration commune de la Fédération luthérienne mondiale et de l’Église catholique, nº 27, DC nº 2168 du 19/10/1997, p. 875 ss.[↩]
- Congrégation du Saint-Office, Décret du 20/12/1949, DC nº 1064 du 12/03/1950, col. 330 ss.[↩]
- Saint Augustin, Sermon au peuple de Césarée prononcé en présence d’Emérite, évêque donatiste, nº 6.[↩]
- Le pape Benoît XIV, dans son admirable De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, l’explique ainsi : si un hérétique établi dans l’ignorance invincible de la vraie foi meurt pour un point de doctrine catholique, il ne peut, même dans ce cas, être considéré comme martyr. En effet, il sera peut-être martyr coram Deo, mais pas coram Ecclesia, car l’Église ne juge que de l’extérieur et l’hérésie professée publiquement oblige à conjecturer l’hérésie interne. (De servorum. c. 20) Quant à l’objection de saint Hippolyte, martyr et antipape (217-235), elle n’est pas à propos. Si le martyrologe le mentionne à la date du 30 octobre, dies natalis du pape saint Pontien, c’est parce qu’Hippolyte s’est réconcilié avec Pontien dans les mines de Sardaigne, avant que tous deux ne subissent le martyre en 236.[↩]
- W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 171-172.[↩]
- W. Kasper, 30 Jours dans l’Église et dans le monde, nº 5/2003, p. 22.[↩]
- Pie IX, encycl. Neminem vestrum du 2 fev. 1854, EP, vol. 1, nº 219.[↩]
- Déclaration de la Commission mixte pour le dialogue entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe du 23/06/1993, dite “de Balamand”, nº 2 et 22, DC nº 2077 du 01/08/1993, p. 711.[↩]
- W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 167. Cf. W. Kasper, Conférence au Kirchentag œcuménique de Berlin, DC nº 2298 du 21/09/2003, p. 817 : « Nous ne pouvons jeter par-dessus bord ce qui nous a portés et tenus jusqu’à présent, ce dont nos devanciers ont vécu, en des circonstances souvent difficiles, et nous ne devons pas attendre cela de nos frères et de nos sœurs du protestantisme et de l’orthodoxie. Ni eux ni nous ne pouvons devenir infidèles. »[↩]
- W. Kasper, L’engagement œcuménique de l’Église catholique, conférence du 23 mars 2002 lors de l’assemblée générale de la Fédération protestante de France, Œcuménisme informations nº 325 (05/2002) et 326 (06/2002).[↩]
- Cf. par exemple Pie IX, Lettre Jam vos omnes du 13/09/1868, ASS 4 (1868), p. 131, DzH 2997 à 2999, invitant les protestants et autres non-catholiques à profiter de l’occasion du concile Vatican I pour revenir à l’Église catholique ; Léon XIII fait de même à l’occasion de son jubilé épiscopal par la Lettre Præclara gratulationis du 20/06/1894, ASS 26 (1894), p. 705 ss. Le texte le plus connu est évidemment celui de Pie XI dans l’encycl. Mortalium animos du 06/01/1928, AAS 20 (1928), p. 14, EP, vol. 1, nº 872 : « L’union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu’en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église du Christ, qu’ils ont jadis eu le malheur d’abandonner. » Ce n’est pas cette pratique du “retour” qui est propre au XIXe siècle, mais plutôt le grand souci des Papes pour cette cause. En effet, cette pratique du “retour” est constante dans l’Église. En 1595, Clément VIII disait par exemple des évêques métropolitains de Kiev (Instruction Magnus Dominus du 23/12/1595) : « Grâce à la lumière du Saint-Esprit qui illuminait leur cœur, ils ont commencé à considérer sérieusement qu’ils n’étaient plus membres du Corps du Christ qu’est l’Église puisqu’ils n’étaient pas liés avec sa tête visible qu’est le Souverain Pontife de Rome. C’est pourquoi ils décidèrent de rentrer dans l’Église romaine qui est leur mère et celle de tous les fidèles. »[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 42.[↩]
- Jean-Paul II, ibid.[↩]
- Congrégation du Saint-Office, Lettre du 16/09/1864, ASS 2, 660.[↩]
- Thren. 5, 7 : « Nos pères ont péché : ils ne sont plus ; et nous, nous portons leurs fautes. »[↩]
- W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 168.[↩]
- Congrégation du Saint-Office, Instruction de Motione œcumenica du 20/12/1949, AAS 42 (1950), p. 144. DC nº 1064 du 12/03/1950, col. 332.[↩]
- 1er schéma préparatoire du concile Vatican I sur l’Église, publié dans EP, vol. 2 p. 8* : « Nous réprouvons l’impiété de ceux qui ferment aux hommes l’entrée du Royaume des cieux, en assurant sous de faux prétextes qu’il est déshonorant et nullement nécessaire au salut d’abandonner la religion – même fausse – dans laquelle on est né, dans laquelle on a été élevé et instruit ; et qui font grief à l’Église elle-même de se donner comme la seule religion véritable, de proscrire et de condamner toutes les religions et sectes séparées de sa communion, comme s’il pouvait y avoir possibilité de participation entre la lumière et les ténèbres, d’accommodement entre le Christ et Bélial. »[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 17.[↩]
- Jean-Paul II, Ut unum sint, nº 18.[↩]
- W. Kasper, Conférence au Kirchentag œcuménique de Berlin, DC nº 2298 du 21/09/2003, p. 820.[↩]
- Conc. œcum. Vat. II, Décr. Unitatis redintegratio, nº 4 ; cf. tout le nº 6.[↩]
- W. Kasper, La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : un motif d’espérance, DC nº 2220 du 20/02/2000, p. 167.[↩]
- Pie XI, encycl. Mortalium animos du 06/01/1928, AAS 20 (1928), p. 14, EP, vol. 1, nº 872.[↩]
- Pie XII, Mystici Corporis, AAS 35 (1943), p. 243, EP, vol. 1, nº 1105.[↩]
- Mgr Lefebvre, Conférence du 14/04/1978.[↩]
- Psaume 11, 2 à 4 : « Au secours, Seigneur, car le saint défaille, car les vérités sont diminuées par les fils des hommes. Ils se disent des mensonges les uns aux autres, ils parlent avec des lèvres trompeuses et un cœur double. Que le Seigneur disperse toutes les lèvres trompeuses et la langue de bois. » Relativement au dernier verset que nous citons, on se reportera utilement au commentaire qu’en fait saint Jean Chrysostome (In Ps. 11, nº 1) : « Ce n’est point contre eux qu’il parle, c’est dans leur intérêt ; il ne demande pas à Dieu de les perdre, mais de mettre fin à leurs iniquités. Il ne dit pas en effet : “Dieu les exterminera” mais “il détruira toutes ces lèvres trompeuses”. Donc, encore une fois, ce n’est point leur nature qu’il souhaite voir anéantie, mais leur langage. »[↩]